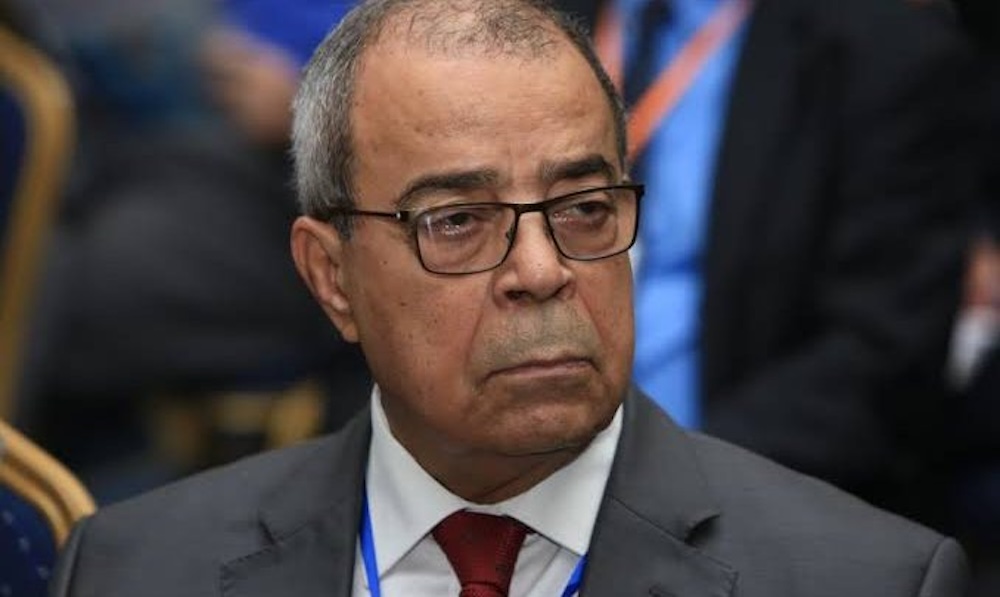Le meurtre d’Asma Oumaïma Moumna, adolescente de quinze ans, tuée par son père à Chlef fin janvier 2026, suscite une émotion considérable. Mais il faut aller au-delà de l’émotion. Ce crime n’est pas un simple fait divers.
Il est un révélateur brutal : en Algérie, la violence contre les femmes et les filles n’est pas seulement une affaire de criminels, mais aussi la conséquence d’une paresse institutionnelle – pour faire dans l’euphémisme – qui voit le danger sans l’empêcher.
Les faits sont connus. C’est la chronique d’une mort annoncée que seule une intervention publique pouvait entraver. Elle n’est pas venue. Asma subissait des violences répétées. Son père avait déjà été incarcéré pour l’avoir grièvement blessée. Elle avait alerté ses proches, son établissement scolaire, puis la gendarmerie. Elle avait dit explicitement : « Il va me tuer. » Malgré cela, elle a été renvoyée chez lui. Il n’est pas difficile d’imaginer la terreur de l’adolescente. Quelques heures plus tard, elle était morte.
Ce qui choque n’est pas seulement la barbarie du geste, mais la chaîne de décisions – ou d’indécisions – qui l’ont rendu possible.
L’alerte existait, le risque était identifié, mais aucune mécanique institutionnelle n’a permis de soustraire une mineure à une autorité parentale devenue mortelle. On a préféré restituer l’enfant à son père plutôt que de la protéger contre lui.
La loi existe… mais reste théorique
L’Algérie ne peut pas dire qu’elle est dépourvue de cadre juridique. Des amendements récents du Code pénal reconnaissent les violences faites aux femmes, aggravent certaines peines et affirment la nécessité de protéger les victimes. Des dispositifs largement neutralisés par la clause dite du pardon. Mais sur le papier, l’État admet donc que la violence domestique ne relève pas de la sphère privée.
Mais la loi reste théorique lorsqu’elle ne rencontre pas la vie concrète. Dans les commissariats et les brigades, la culture dominante reste celle de la conciliation, du rappel à l’ordre, de l’engagement signé, plutôt que celle de l’évaluation du danger. Un texte de loi existe, la chaîne de protection n’existe pas.
Une invisibilisation honteuse
La prévention exige autre chose qu’un procès-verbal ou une admonestation. Elle impose que la parole d’une victime déclenche automatiquement une mise à l’abri, une suspension réelle de l’autorité du violent, qu’il soit père, mari ou frère, un suivi judiciaire, parfois une protection policière. Dans l’affaire de Chlef, on n’a pas pensé en termes de sauvegarde de la vie, mais en termes de restauration de l’ordre familial.
C’est là, dans cette sacralisation de la famille, que se niche le problème algérien. Tant que l’autorité patriarcale primera sur le droit à la vie, la protection restera un slogan.
À cela s’ajoute l’invisibilisation : pas de chiffres officiels consolidés sur les féminicides, pas d’observatoire national réellement opérationnel.
Les rares comptages sont assurés par des militantes, comme le site et la page Féminicides DZ, qui travaillent à partir des articles de presse, donc d’une réalité fragmentaire. Ce que l’État ne compte pas n’existe pas politiquement.
L’exemple espagnol
La comparaison avec l’Espagne est éclairante. Là aussi, le machisme est une réalité sociale. Mais l’État a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et a fait du féminicide une question publique centrale. Chaque meurtre de femme donne lieu à une manifestation officielle devant le siège de la mairie, en présence des autorités, afin d’éviter l’invisibilisation des victimes et d’affirmer une responsabilité collective.
Surtout, l’alerte y déclenche une chaîne concrète de protection : ordonnances d’éloignement rapides, juges et parquets spécialisés, téléphones d’urgence pour les victimes, parfois bracelets électroniques empêchant l’agresseur d’approcher. La logique n’est pas seulement punitive mais préventive : identifier le danger, mettre à l’abri, suivre la situation. La loi y est pensée comme un outil vivant. Pas un texte que l’on brandit après la mort, mais un système qui agit avant le passage à l’acte.
Cet exemple mérite d’être regardé en Algérie, où la femme reste trop souvent perçue comme une dépendance du mari ou du père, un bien à restituer plutôt qu’une personne à protéger. L’autorité masculine continue d’y peser plus lourd que le droit à la vie. Tant que la logique patrimoniale de la famille primera sur la sécurité des femmes, aucune réforme ne produira d’effet réel.
Un féminicide annoncé
L’affaire Asma rappelle une vérité dérangeante : un féminicide n’est presque jamais soudain. Il est précédé de signaux. Asma les avait envoyés. Elle avait annoncé son futur meurtre avant qu’il ne se produise.
Avant de réclamer des châtiments exemplaires après chaque drame, il faut poser une question plus inconfortable : pourquoi l’État n’agit-il pas quand les signaux de menace sont évidents, palpables, concrets ? Pourquoi une signature sur un engagement prendrait-elle le pas sur la parole d’une adolescente terrorisée ?
Le féminicide n’est pas une fatalité culturelle. C’est un échec institutionnel. Et tant que la prévention restera absente, chaque nouvelle victime portera non seulement la responsabilité de son bourreau, mais aussi celle d’un système qui regarde le danger sans le stopper. Et que l’on n’invoque pas les traditions ou la religion : tuer injustement une vie, c’est comme si l’on avait tué l’humanité entière.