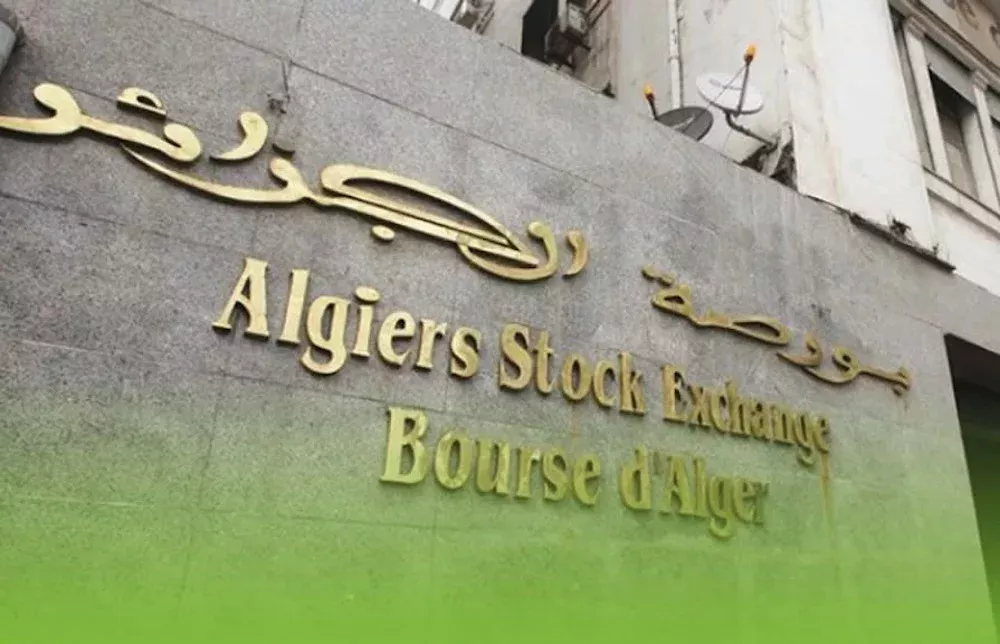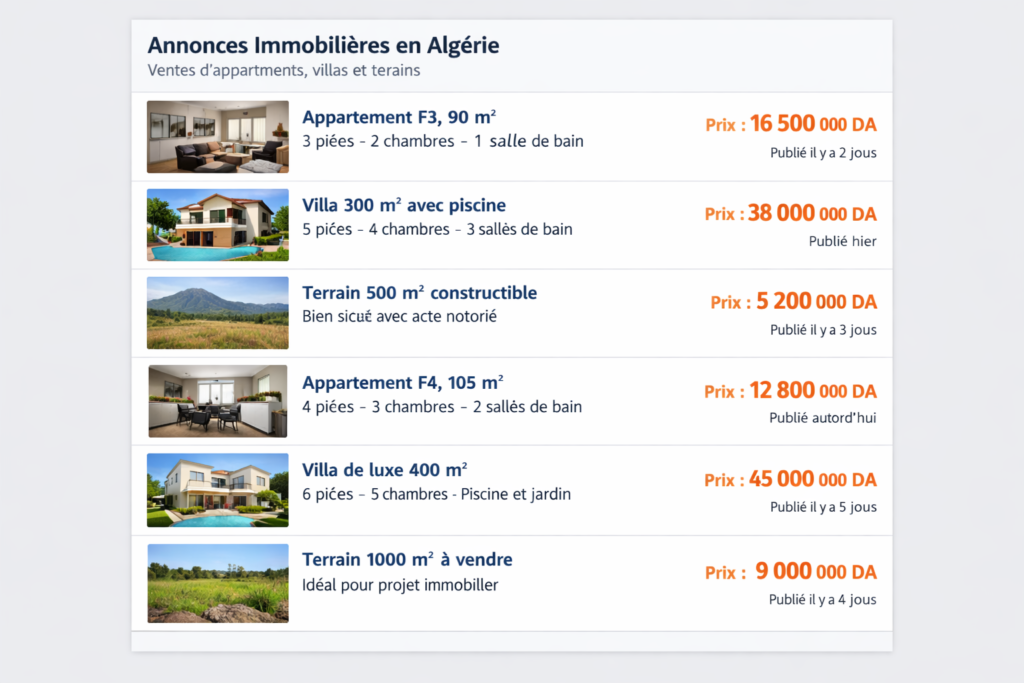L’agriculture représente l’un des piliers de l’économie nationale. Elle constitue une alternative stratégique à la dépendance aux hydrocarbures et joue un rôle central dans la quête de sécurité alimentaire, un enjeu prioritaire pour les autorités ces dernières années.
Aujourd’hui, les produits agricoles se classent en deuxième position parmi les exportations du pays, illustrant l’importance croissante de ce secteur dans la dynamique de développement économique. Lors de la 26ᵉ édition du Salon International de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Agroéquipement (SIPSA), l’accent a été mis sur le potentiel agricole des régions sahariennes, avec un regard porté à la fois sur les opportunités et les défis liés à l’investissement dans ces territoires.

Le Sahara, nouveau front agricole
Le Sahara algérien apparaît désormais comme un nouveau levier stratégique pour l’agriculture nationale. De vastes superficies, un ensoleillement permanent, l’accès à l’électricité et aux forages profonds, ainsi que le soutien croissant des institutions financières en faveur des crédits agricoles, en font une zone à fort potentiel. Cette dynamique attire de jeunes entreprises innovantes, mais aussi des groupes installés de longue date, qui investissent massivement dans l’agriculture saharienne.
Farme Seed Company : la relève jeune et ambitieuse
Fondée par sept jeunes ingénieurs algériens fraîchement diplômés, Farme Seed Company incarne la nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles. Avec pour slogan « Ensemble, nous semons l’avenir », cette entreprise s’est imposée en seulement trois ans sur le marché national. Après une première expérience dans le nord du pays, elle est désormais active dans plusieurs wilayas du sud, dont Ouargla, Biskra, El Meghaïer et Ouled Djellal.

« Notre objectif est de produire des semences locales afin de réduire notre dépendance aux importations, qui sont non seulement coûteuses, mais ont également un impact direct sur le prix des produits alimentaires », explique Radia Dahoui, ingénieure chez Farme Seed Company.
Groupe Tahraoui : un modèle d’intégration
Présent à Biskra depuis 1974, le Groupe Tahraoui est un acteur historique du secteur agricole algérien. Avec ses multiples filiales, le groupe couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : irrigation, accessoires pour serres, emballage, logistique… Une intégration verticale essentielle pour surmonter les difficultés structurelles qui affectent les entreprises du Sud, notamment en matière d’approvisionnement et de distribution.

Bien que certains composants soient encore importés, la stratégie du groupe visant à assurer une couverture complète de ses besoins agricoles en fait une référence pour les investisseurs intéressés par le Sahara.
ISS Irrigal : l’innovation au service de l’irrigation
La société ISS Irrigal, basée à Sétif, est spécialisée dans la fabrication de systèmes d’irrigation. Active dans 13 wilayas, elle s’est lancée avec des moyens propres après plus de dix ans d’expérience dans le domaine. Aujourd’hui, elle importe ses matières premières depuis l’Arabie saoudite et compte des clients dans tout le pays, y compris à Adrar.

« Nous avons créé notre entreprise avec nos fonds personnels et notre expertise. Aujourd’hui, nous servons des agriculteurs dans plusieurs régions et devenons un modèle pour les jeunes qui veulent investir dans ce secteur », affirme Yakoub Chouar, fondateur d’ISS Irrigal.
Cosider Agrico : l’engagement public structurant
Cosider Agrico, filiale agricole du groupe public Cosider, joue un rôle structurant dans le développement de l’agriculture au Sahara. Créée en 2017, elle est présente dans trois wilayas : Khenchela (17 000 ha), Touggourt (4 022 ha) et Adrar (16 000 ha). Ses activités couvrent diverses filières : céréales, arboriculture, pépinières, etc.
Cette présence étendue illustre la volonté de l’État de renforcer la souveraineté alimentaire nationale par un investissement massif dans les régions sahariennes.
Défis à surmonter
Malgré ces dynamiques prometteuses, plusieurs obstacles freinent encore l’essor de l’agriculture saharienne. Le manque d’infrastructures logistiques constitue l’un des freins majeurs au développement, notamment en ce qui concerne le transport, le stockage et la distribution des produits agricoles. À cela s’ajoute le coût élevé des intrants importés -semences, engrais, équipements- qui pèse sur les producteurs et réduit leur compétitivité.
La gestion durable des ressources en eau reste un enjeu critique dans une région où les nappes phréatiques sont surexploitées et où le climat aride accentue le stress hydrique. De plus, l’accès limité à la formation technique et à l’innovation freine l’adoption de pratiques agricoles modernes adaptées aux spécificités sahariennes. Enfin, les conditions climatiques extrêmes, conjuguées à la raréfaction progressive des ressources en eau, posent un défi sérieux à la pérennité de l’activité agricole dans ces zones.
L’agriculture saharienne n’est plus un simple projet d’expérimentation. Elle devient une composante essentielle de la stratégie économique et alimentaire de l’Algérie. Entre initiatives privées audacieuses et investissements publics structurés, le Sahara est en passe de devenir un véritable grenier du sud. Toutefois, pour réussir cette transformation, il est impératif de relever les défis techniques, environnementaux et logistiques qui freinent encore son plein développement.