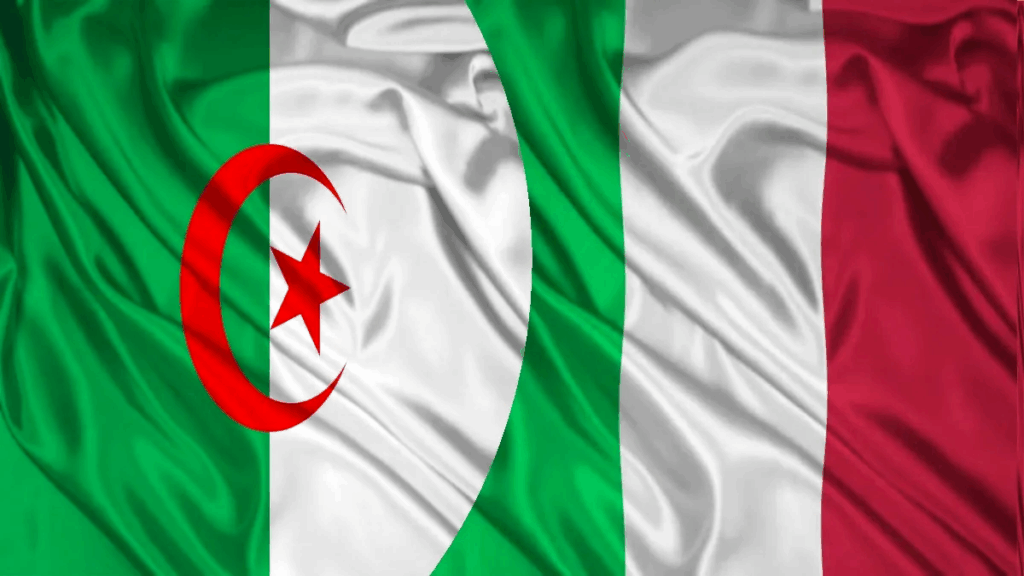La Banque mondiale a publié hier son rapport sur l’Algérie. La croissance affiche 4,1%, les secteurs hors hydrocarbures progressent. Mais les déficits, eux, explosent.
Le récit officiel est rodé. L’économie algérienne serait entrée dans une nouvelle phase, plus « diversifiée », plus « résiliente », portée par des secteurs hors hydrocarbures enfin dynamiques. Les chiffres publiés hier par la Banque mondiale le confirment en partie : la croissance est réelle. Mais dès qu’on regarde les comptes publics et extérieurs dans le détail du rapport, une autre réalité apparaît. Cette croissance repose sur des déséquilibres massifs, financés par un État très déficitaire et par une économie qui importe beaucoup plus qu’elle ne gagne en devises.
Les données de la BM montrent une économie qui accélère, mais en s’appuyant sur des fondations fragiles. C’est ce décalage entre le discours triomphant et les équilibres macroéconomiques qui mérite d’être mis au centre du débat.
Une économie qui accélère, mais au prix d’un trou budgétaire historique
Sur le plan de l’activité, les chiffres sont indiscutables. Au premier semestre 2025, le produit intérieur brut augmente de 4,1 % en glissement annuel, selon le rapport semestriel de la Banque mondiale intitulé « Répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable ». La croissance est encore plus forte dans les secteurs hors hydrocarbures, avec une progression de 5,4 %. L’investissement bondit de 13,2 %. La consommation privée reste solide, avec une hausse de 4,4 %.
L’inflation, elle, recule à 1,7% sur les neuf premiers mois, portée par la baisse des prix des denrées alimentaires et la performance du secteur agricole. En apparence, le pays semble enfin sortir du tête-à-tête avec la rente pétrolière. “L’allégement des pressions sur les prix et la performance soutenue des secteurs hors hydrocarbures constituent des signaux encourageants”, a déclaré Daniel Prinz, économiste de la BM pour l’Algérie, lors de la présentation du rapport.
Sauf que la situation budgétaire raconte une tout autre histoire. En 2024, le déficit public atteint 13,8 % du PIB, contre 5,5 % un an plus tôt. C’est un saut considérable. Les recettes tirées des hydrocarbures reculent fortement, de 19,1 % à 11,1 % du PIB, sous l’effet de prix plus faibles et de volumes d’exportation réduits. Les recettes fiscales hors hydrocarbures diminuent également, de 10,4 % à 9,4 % du PIB, alors que les dépenses restent très élevées, autour de 37 % du PIB.
Le déficit hors hydrocarbures grimpe, quant à lui, à 24,8 % du PIB. Autrement dit, sans la rente, l’État vit très largement au-dessus de ses moyens. Le déficit dit “structurel” est estimé à 10,1 % du PIB. Même avec une conjoncture favorable, ce trou ne disparaît pas. Il ne s’agit donc pas d’un simple accident lié à un mauvais millésime pétrolier, mais d’un modèle de finances publiques déséquilibré.
Pendant des années, les autorités ont pu compenser ces dérives grâce aux épargnes issues des périodes de pétrole cher. Ce coussin est désormais épuisé. Les marges de manœuvre se sont refermées. Désormais, chaque point de déficit supplémentaire se traduit par davantage de dette publique. C’est un choix lourd, qui engage les finances de long terme sans réel débat public.
Daniel Prinz estime que “le maintien de ces avancées, grâce à la poursuite des réformes, peut soutenir une croissance plus vigoureuse, durable et diversifiée”. Mais le rapport de la BM dit peu que cette stratégie est financée par un déficit massif, dans un contexte où la capacité à reconstituer des réserves grâce aux hydrocarbures se réduit.
Une croissance tirée par les importations et le retour des déficits jumeaux
Le deuxième angle mort du discours se situe sur le front extérieur. “Ce qui caractérise l’économie algérienne durant le premier semestre est la poursuite de la croissance de l’investissement qui s’est encore accélérée durant cette période, stimulant ainsi la hausse des importations”, a précisé Amel Henider, économiste de la BM, lors de la conférence de presse.
Les volumes d’importation augmentent de 25,2 % au premier semestre 2025, après déjà 11,9 % de hausse en 2024. Dans le même temps, les volumes d’exportation se contractent de 1,3 %, en grande partie à cause d’une baisse du PIB des hydrocarbures de 2 %.
Résultat, le compte courant, qui mesure les flux nets de devises, replonge dans le rouge. En 2024, le déficit s’élève à 2,9 milliards de dollars, soit 1,1 % du PIB. Sur le seul premier semestre 2025, il explose à 10,5 milliards de dollars. Les réserves de change passent de 16,4 mois d’importations à 15 mois en un an et continuent de s’éroder.
Le constat est sans appel. Le pays importe massivement pour alimenter sa croissance, mais ses recettes en devises ne suivent pas. Ce n’est pas une croissance portée par des exportations diversifiées et compétitives. C’est une croissance largement alimentée par la demande interne et par l’investissement, qui se traduit par une fuite importante de devises.
Les crédits bancaires destinés au secteur privé ont bondi de 10,4% au premier semestre, notamment pour financer leurs investissements, selon le rapport de la BM. La politique monétaire est restée globalement « accommodante », favorisant cet afflux de crédit. Mais cet investissement se tourne massivement vers des équipements et des intrants importés.
La combinaison d’un déficit budgétaire à deux chiffres et d’un déficit extérieur en forte hausse renvoie à un scénario bien connu des économistes : celui des « déficits jumeaux ». L’État dépense beaucoup plus qu’il ne perçoit. Le pays, lui, achète à l’étranger beaucoup plus qu’il ne vend. Tant que les conditions financières restent favorables et que les prix de l’énergie ne s’effondrent pas, cette situation peut tenir. Mais elle augmente la vulnérabilité du pays aux chocs externes.
Des prévisions optimistes qui masquent les fragilités
La Banque mondiale prévoit une croissance de 3,8% pour 2025, puis 3,5% en 2026 et 3,3% en 2027, “soutenue par les secteurs hors hydrocarbures et la reprise de la production pétrolière et gazière”. Cette reprise des hydrocarbures s’appuie sur une hypothèse : la hausse progressive des quotas algériens dans le cadre des ajustements de l’OPEP+.
L’institution financière internationale estime que la consommation privée continuerait de stimuler les services “en expansion”, que la production agricole resterait “résiliente” et que l’investissement demeurerait “dynamique” durant les deux prochaines années.
Ces prévisions sont techniquement solides. Mais elles reposent sur un pari : que le modèle actuel, fortement déficitaire, puisse se poursuivre sans ajustement majeur. Qu’un État qui dépense 37% du PIB avec des recettes de 23% puisse continuer longtemps sans conséquences. Que des réserves de change qui s’érodent puissent absorber indéfiniment un déficit extérieur croissant.
Le gouvernement a raison de se féliciter d’une croissance qui repart. Mais il a tort d’ignorer, ou de minimiser, le coût de cette trajectoire. Une économie qui progresse avec un déficit public de près de 14 % du PIB et un compte courant lourdement déficitaire ne peut pas se prétendre solide. Elle avance sur une ligne étroite, en misant sur la capacité future à financer une dette croissante et à stabiliser ses réserves de change.
Ce qui compte maintenant, ce n’est pas tant de savoir si la croissance est robuste cette année – elle l’est, numériquement. C’est de savoir si le pays peut continuer longtemps à croître sur ce modèle, sans ajustement budgétaire sérieux et sans vraie stratégie pour réduire sa dépendance aux importations et aux hydrocarbures. Pour l’instant, les chiffres de la Banque mondiale, malgré leur ton optimiste, indiquent que non.