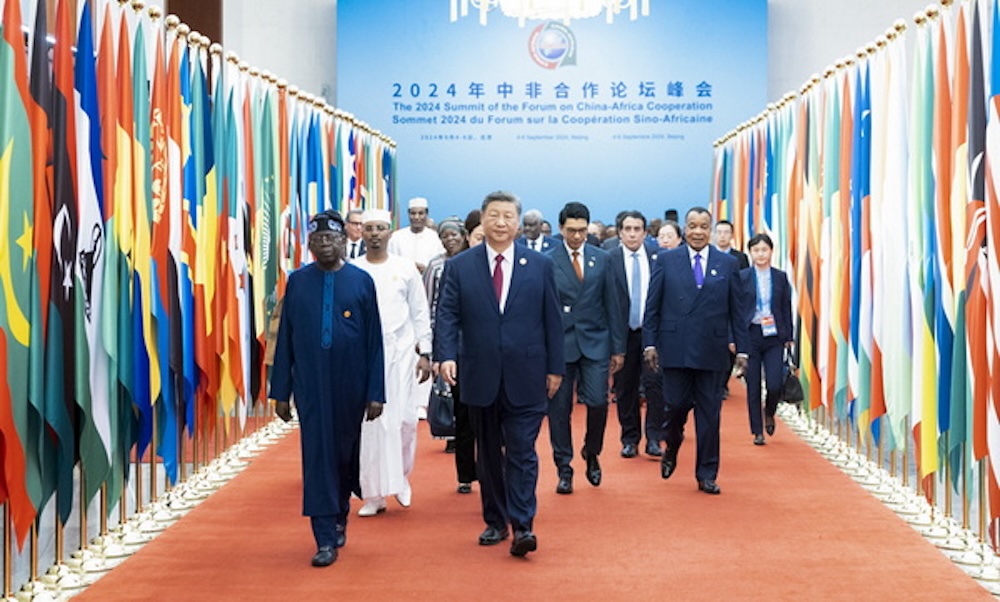L’Afrique du Nord connaît une course effrénée aux investissements énergétiques. Algérie, Libye et Égypte déploient des stratégies différentes pour attirer les capitaux étrangers, mais toutes visent le même objectif, à savoir optimiser leurs ressources tout en diversifiant leurs partenariats.
Les trois géants énergétiques nord-africains naviguent aujourd’hui entre opportunités et contraintes, mais chacun avec sa propre boussole. L’Algérie mise sur la stabilité et l’ambition avec un plan d’investissement colossal de 36 à 50 milliards de dollars sur 2024-2028, comme le rapporte Attaqa. Le pays vise une production de 200 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an d’ici 2030, soit une hausse de près de 50 % par rapport à ses capacités actuelles. Cette stratégie proactive s’appuie sur des appels d’offres réguliers et une réforme du secteur qui attire les majors internationales comme Eni, Oxy, Chevron ou Cepsa.
À l’opposé, la Libye adopte une approche de rattrapage après des années de turbulences. Le pays a lancé en 2025 son premier appel d’offres pour l’exploration pétrolière et gazière depuis 17 ans, ciblant les bassins de Murzuq, Ghadames et Sirte. Selon Attaqa, l’objectif libyen est d’atteindre 2 millions de barils de pétrole et 4 milliards de pieds cubes de gaz par jour dans les cinq prochaines années. Toutefois, les investisseurs restent prudents face aux risques sécuritaires persistants, ce qui limite la portée de cette relance.
L’Égypte, quant à elle, joue la carte de l’urgence. Confrontée à une chute drastique de sa production gazière depuis 2023, notamment due au déclin du gisement géant de Zohr, Le Caire multiplie les appels d’offres en Méditerranée. Le gouvernement égyptien cherche à rassurer les investisseurs par des incitations financières et une meilleure gestion des arriérés de paiement, avec pour objectif de rétablir la production d’ici l’été 2025.
Des partenariats en quête de diversification
La diversification des alliances constitue le dénominateur commun de ces trois stratégies. L’Algérie se distingue par une approche structurée, multipliant les partenariats avec l’Europe pour les énergies renouvelables et l’hydrogène vert. Le pays exploite méthodiquement ses immenses réserves, notamment les gisements de Hassi R’Mel et Hassi Messaoud, garantissant une production stable pour plusieurs décennies.
La Libye privilégie des partenariats ciblés, notamment avec Eni pour développer de nouveaux champs offshore et terrestres. Le pays cherche également à valoriser ses ressources gazières sous-exploitées via des projets comme la compression de Sabratha. Parallèlement, la première centrale solaire libyenne, développée avec TotalEnergies, marque les débuts timides du pays dans la transition énergétique.
L’Égypte déploie une stratégie tous azimuts, associant Eni, Chevron, ExxonMobil et TotalEnergies à ses projets. Attaqa souligne que le pays mise massivement sur les énergies renouvelables, visant 42 % de capacités renouvelables dans son mix énergétique d’ici 2030, avec des partenariats comme celui entre Meridiam, Hassan Allam Utilities et la BERD.
Stabilité contre urgence : des philosophies qui se révèlent
Ces stratégies révèlent des philosophies distinctes. L’Algérie capitalise sur sa stabilité politique et économique pour planifier sur le long terme, ce qui lui confère un avantage certain face aux investisseurs internationaux. Sa gestion méthodique des réserves contraste avec les approches plus réactives de ses voisins.
La Libye doit composer avec l’héritage de l’instabilité, ce qui freine l’exploitation de son considérable potentiel pétrolier et gazier. Les investisseurs demeurent circonspects malgré les efforts de relance, obligeant le pays à offrir des conditions particulièrement attractives.
L’Égypte navigue entre crise et opportunité. La chute de production l’oblige à réagir rapidement, mais cette pression stimule également l’innovation et accélère la transition énergétique. Le pays compense ses défaillances dans les hydrocarbures par des investissements massifs dans le renouvelable.
Ces trois nations partagent néanmoins des défis similaires : attirer les capitaux étrangers dans un contexte mondial incertain, diversifier leurs économies trop dépendantes des hydrocarbures, et répondre aux attentes croissantes en matière de durabilité. Leurs stratégies différenciées reflètent autant leurs spécificités nationales que leur volonté commune de rester compétitives dans la course énergétique régionale. L’issue de cette compétition dépendra largement de leur capacité à concilier impératifs économiques immédiats et transition énergétique à long terme.