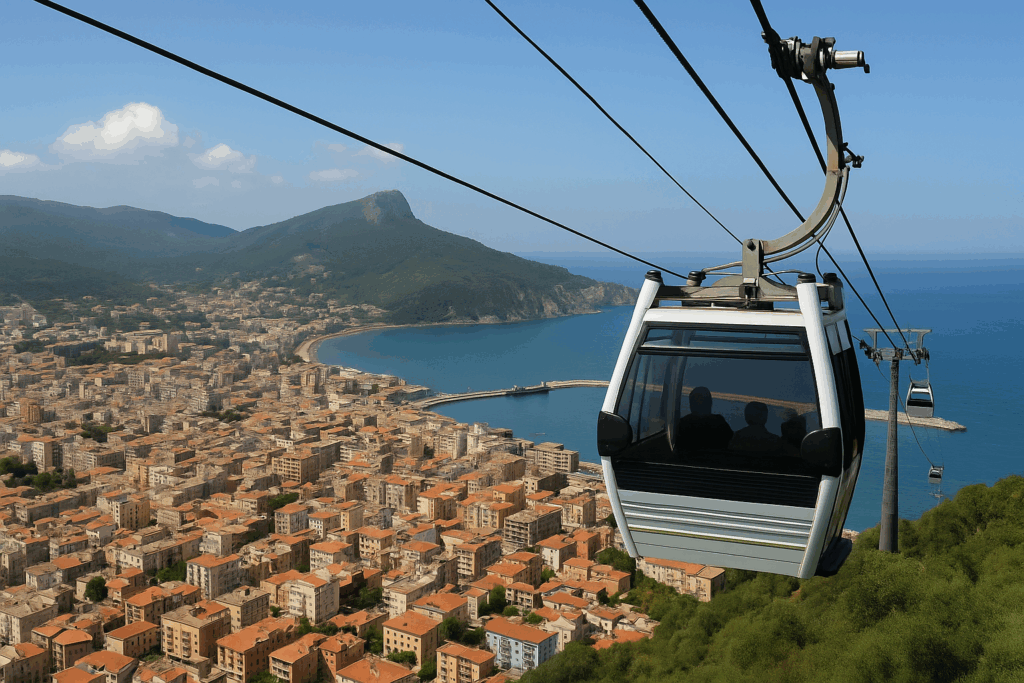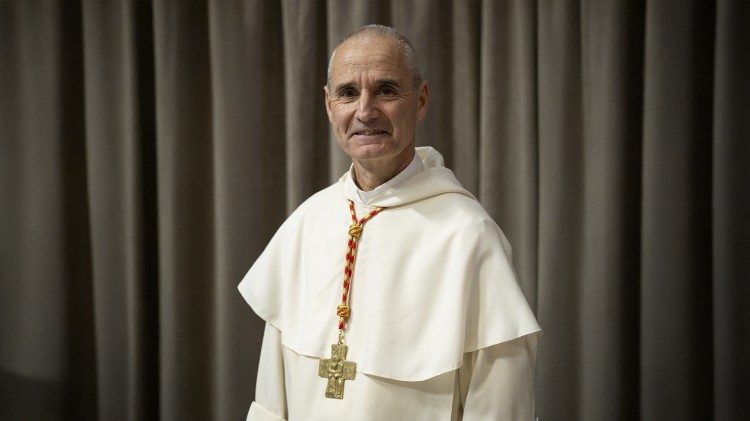Avec un budget record de 126 milliards de dollars, l’Algérie fait le pari de la paix sociale. Mais cette stratégie peut-elle tenir face aux défis économiques structurels du pays ?
Un chômeur touche son allocation, un retraité perçoit sa pension, les produits de première nécessité sont distribués à prix subventionnés. Ces gestes du quotidien représentent 5 928 milliards de dinars (44,6 milliards de dollars) dans le budget 2025, soit 37 % des dépenses publiques. Cette proportion place l’Algérie parmi les pays les plus généreux de la région en matière de solidarité, dans le cadre d’un budget global fixé à 16 794 milliards de dinars (126 milliards de dollars). Cette manne englobe également les programmes de logement social. Parallèlement, la masse salariale publique absorbe 5 843 milliards de dinars, soit 34,8 % du budget total.
Un tel niveau de dépenses sociales et salariales n’est pas seulement un choix politique : il traduit aussi une contrainte économique liée à la démographie. Avec 45 millions d’habitants dont plus de la moitié a moins de 30 ans, l’Algérie fait face à une demande sociale explosive. Les jeunes diplômés cherchent du travail, les familles ont besoin de soutien, la pression sur l’emploi public ne faiblit pas.
Le gouvernement tente de répondre à cette pression en créant 97 000 nouveaux postes budgétaires, principalement dans l’éducation et la santé. Une réponse quantitative qui traduit l’urgence sociale mais interroge sur la viabilité économique.
Car derrière cette générosité se cache un déséquilibre financier préoccupant. Les recettes de l’État ne couvrent que la moitié des dépenses : 8 523 milliards de dinars de revenus face à 16 794 milliards de dépenses. Le déficit budgétaire atteint 21,8 % du PIB, un niveau particulièrement élevé au regard des standards internationaux.
Une dépendance persistante aux hydrocarbures
L’équation devient encore plus fragile quand on examine la structure des recettes. 3 454 milliards de dinars proviennent de la fiscalité pétrolière, soit plus de 40 % des revenus de l’État. Cette dépendance aux hydrocarbures expose directement le budget aux fluctuations imprévisibles des marchés internationaux.
Heureusement pour Alger, les réserves de change offrent une bouée de sauvetage confortable. Avec 73 milliards de dollars en réserve, l’équivalent de seize mois d’importations, le pays dispose d’une marge de manœuvre temporaire. Mais cette richesse accumulée ne peut indéfiniment compenser les déséquilibres structurels.
L’allocation des ressources révèle les priorités nationales. Défense, éducation, santé et intérieur se partagent plus de 60 % du budget. Ces secteurs régaliens bénéficient respectivement de 3 349, 1 645, 1 004 et 1 365 milliards de dinars, montrant la volonté de l’État de maintenir ses fonctions essentielles.
Cette stratégie budgétaire reflète un choix politique assumé : privilégier la stabilité sociale à court terme. Dans un pays où les souvenirs du Printemps arabe restent présents, maintenir la paix civile par la redistribution constitue une priorité absolue pour l’État.
Pourtant, cette approche soulève des interrogations sur sa durabilité. Le poids combiné du social et de la masse salariale, face à la volatilité des recettes pétrolières, crée une équation financière instable. Sans diversification économique réelle et réformes structurelles, ce modèle généreux pourrait devenir un piège.