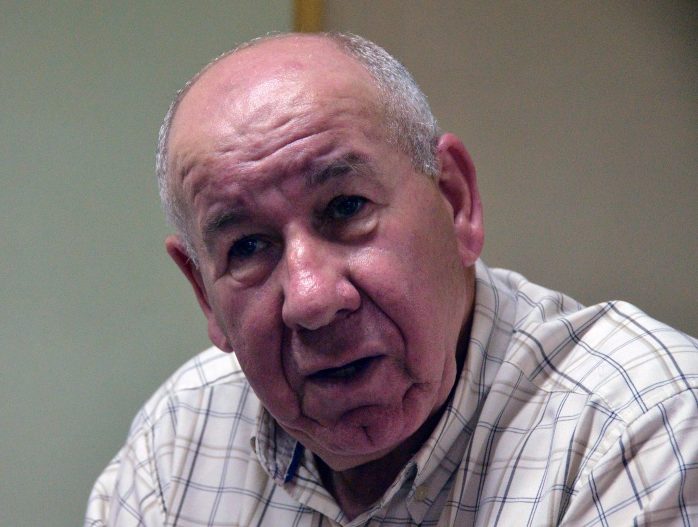Un choix stratégique incontournable pour l’Algérie
La mise en œuvre d’un plan d’action triennal apparaît aujourd’hui comme une urgence stratégique pour l’Algérie. Les coûts et bénéfices de ce programme doivent être systématiquement mis en comparaison avec les coûts engendrés par un maintien du statu quo. Ce plan associerait des mesures à court terme (2026–2028) à une stratégie cohérente à moyen terme, inscrite dans une vision 2050 visant à hisser le pays au rang d’économie émergente. Les objec-tifs prioritaires globaux sont de corriger les déséquilibres macroéconomiques persistants, lever les rigidités structurelles du modèle économique et social actuel, et engager l’économie sur une trajectoire de croissance durable, inclusive et résiliente. Cet article évalue les coûts et bénéfices attendus d’un tel programme — incluant l’assainissement budgétaire, la réforme du régime de change, la transformation structurelle et le renforcement institutionnel de l’économie — et les compare aux risques économiques et sociaux associés au maintien du statu quo. Les réformes entraîneraient des coûts d’ajustement à court terme qui sont estimés entre 10 et 15% du PIB cumulé sur la période 2026–2028. Cependant, ces efforts doivent être perçus comme un investissement indispensable pour le retour à la stabilité macroéconomique (y compris l’incontournable viabilité des finances publiques) et à la relance de l’investissement privé et de la croissance et de l’emploi. Si elles sont mises en œuvre de manière progressive et cohérente et accompagnées d’une communication transparente et continue, ces réformes pourraient restaurer la confiance, éliminer les déséquilibres, renforcer la compétitivité, générer des gains durables en productivité et réduire les écarts de revenus. A l’inverse, l’absence de réformes accentuerait les vulnérabilités existantes, notamment l’érosion des réserves de change, la persistance des pressions inflationnistes, l’accroissement de l’endettement public et la dégradation du climat des affaires. A plus long terme, le statu quo compromettrait durablement la diversification économique, la création d’emplois et la cohésion sociale. Discutons de ces points. Top of Form Bottom of Form
Les données macroéconomiques 2024 (FMI) confirment la non-viabilité des finances publiques et les impacts négatifs sur la qualité de la croissance et la stabilité macroéconomique. Avec 3,8% de croissance – légèrement au-dessus du potentiel – portée par l’agriculture, la construction et les services, tandis que le secteur pétrolier reste modéré (+2,7%), l’expansion économique repose largement sur un recours accru à la dette publique, au prix d’une inflation persistante et d’une fragilisation budgétaire accrue. Le surplus courant a baissé à 1,3% du PIB (contre 2,5% en 2023), limitant les marges de manœuvre extérieures, tandis que le déficit budgétaire hors hydrocarbures demeure excessif (29,5% du PIB hors pétrole, bien au-dessus du seuil de viabilité de 11%). Malgré un léger recul, la dette publique reste élevée (45,7% du PIB contre 48,6% en 2023). Cette configuration alimente un cercle vicieux macro-financier : l’épargne bancaire est absorbée par le financement du déficit, évinçant l’investissement privé productif ; les tensions inflationnistes et la dépréciation du dinar minent la confiance des agents économiques ; le secteur bancaire, dominé par des établissements publics, se refinance à 2,75 – 3% et privilégie les bons du Trésor (dont les taux de rendement sont de 5,5 – 5,75%) pour générer des marges sans risque, au détriment du crédit à l’économie réelle ; et la qualité des portefeuilles se détériore, fragilisée par l’exposition aux entreprises publiques peu rentables. Ces déséquilibres interconnectés compromettent à la fois la viabilité budgétaire et la stabilité financière à moyen terme.
Algérie 2025 : vers une plus grande détérioration économique amplifiée par lescontraintes internes et des chocs géopolitiques, économiques, climatiques et technologiques. Les conflits internationaux, les tensions sino-américaines, le protectionnisme et surtout la politique tarifaire américaine pèsent sur la croissance mondiale, ravivent l’inflation et pourraient ouvrir la voie à une stagflation. Le marché pétrolier stagne, entre demande faible et offre abondante hors OPEP . Ces facteurs s’ajoutent aux défis internes qui limitent l’action publique, notamment un modèle rentier à bout de souffle, une forte croissance démographique, les dégâts causés par le changement climatique, la fragilité administrative et l’inefficacité des leviers macroéconomiques. De ce fait, la croissance devrait ralentir à 3%, portée par une hausse des dépenses publiques (44,4% du PIB). Le secteur pétrolier croîtrait faiblement (+1,5%) et le hors-pétrole atteindrait 3,2%. L ’inflation resterait stable à 5,2%, atténuée par la baisse des prix alimentaires. Le compte courant passerait en déficit (-0,8% du PIB), alors que le déficit hors hydrocarbures, bien qu’en léger recul, resterait élevé (26,6% du PIB hors pétrole). La dette publique remonterait à 50,4% du PIB, un niveau préoccupant.
Sur le moyen terme (2027), le statu quo contribuerait à une plus grande dégradation des principaux indicateurs de performance du pays et à un affaiblissement de sa dynamique économique. Trois points :
La transmission et l’amplification des déséquilibres macroéconomiques qui ne sont pas pris en charge : une dégradation progressive des comptes extérieurs provoquerait une érosion continue des réserves de change et une baisse des recettes pétrolières, ce qui limiterait la capacité d’importation, perturberait l’approvisionnement en biens essentiels et exacerberait les pressions inflationnistes. Dans ce contexte, la croissance économique ralentirait et les recettes fiscales ordinaires diminueraient. Cette dégradation des finances publiques entraînerait un recours accru au financement monétaire du déficit, amplifierait l’endettement public et accentuerait la hausse des prix. Il favoriserait en outre l’orientation de ressources publiques rares vers le maintien de la survie du secteur public, au détriment de l’investissement productif, renforçant ainsi un cercle vicieux économique. Cette situation exercerait une pression supplémentaire sur le dinar, fragiliserait un secteur bancaire déjà fortement orienté vers la souscription aux bons du Trésor au lieu du financement de l’économie réelle et intensifierait l’instabilité financière.
Une plus grande dégradation macroéconomique à l’horizon 2027. Au cours des 25 dernières années, la croissance économique algérienne est restée inférieure à 3% par an, avec une inflation moyenne autour de 4% et des recettes fiscales stabilisées à 11% du PIB (en deçà de l’objectif optimal de 15% du PIB). Cette stagnation reflète un sous-emploi structurel des capacités économiques et une sous-performance chronique des finances publiques, entraînant des pertes lourdes en termes de développement et de bien-être. Sans réformes, cette dégradation s’aggravera entre 2025 et 2027 : la croissance ralentira de 3 à 2,1%, creusant un écart cumulé dépassant 10% du PIB (26 milliards de dollars) par rapport à une trajectoire réformée (4-5%). Les recettes fiscales ordinaires se contracteront, aggravant un déficit hors hydrocarbures pouvant excéder 25% du PIB hors pétrole, avec un manque à gagner estimé entre 3 et 4 points de PIB par an, réduisant les financements publics essentiels. La dette publique, déjà élevée (50,4% du PIB en 2025), dépassera 54% en 2027, augmentant la vulnérabilité des finances publiques. L ’inflation resterait élevée (environ 5%), au-dessus de la cible implicite de 4%, tandis que la dégradation du pouvoir d’achat et le creusement des inégalités exacerberaient les tensions sociales, compromettant stabilité économique, investissement et diversification.
Impacts négatifs sur la compétitivité, la productivité, la diversification et la répartition du revenu national : Sur le plan structurel, cette trajectoire compromet durablement la compétitivité externe, pénalisée par l’inflation, la dépréciation réelle du dinar et la dépendance quasi exclusive aux hydrocarbures, exposant l’économie aux fluctuations des prix internationaux. L ’investissement privé restera faible, freiné par l’incertitude macroéconomique, le risque de change et un climat des affaires peu favorable, ce qui entrave la modernisation et le développement de secteurs exportateurs diversifiés. L ’inertie structurelle alimentera un chômage élevé et chronique, accentué par un désalignement entre qualifications et besoins du marché, favorisant la fuite des talents. Le retard technologique et énergétique se creusera, limitant l’adaptation aux transitions mondiales et les gains de productivité à long terme. Par ailleurs, le secteur bancaire, captif du financement de la dette souveraine et soumis à une érosion de ses marges en devises, réduira son intermédiation vers l’économie réelle. Ce phénomène de «crowding-out» du crédit productif affaiblira davantage le potentiel de croissance et accroîtra la vulnérabilité du système financier face aux chocs de confiance. Dernier élément, la répartition du revenu national en Algérie souffre de la dépendance aux hydrocarbures, des écarts de salaires public-privé, des disparités régionales et d’une économie informelle importante. Sans réformes globales et cohérentes — subventions ciblées, développement du privé, protection sociale renforcée —, les inégalités vont s’aggraver, mettant en danger la cohésion sociale.
Analyse coûts/bénéfices des réformes et gap de financement pour 2026. La fenêtre 2026–2028 offres une opportunité décisive pour engager des réformes structurelles et macroéconomiques profondes pour restaurer la viabilité budgétaire, réduire les vulnérabilités externes, soutenir la croissance inclusive, tout en réorientant le modèle économique vers la diversification, la productivité et l’innovation. Toutes ces reformes entraîneraient des coûts d’ajustement à court terme qui doivent être perçus comme un investissement indispensable si elles sont mises en œuvre de manière progressive et cohérente.
Coût estimatif du programme de réformes (2026–2030) : aux environs de 100 milliards de dollars, soit 10 à 15% du PIB cumulé sur trois ans, incluant l’absorption du déficit budgétaire, la réduction du déficit de la balance des paiements ainsi que des investissements structurels (infrastructures, transition énergétique, capital humain). Ce coût intègre également les grandes réformes macroéconomiques, telles que la restauration de la viabilité des finances publiques et l’ajustement graduel du taux de change accompagné d’un resserrement progressif du cadre monétaire avec un soutien transitoire à la liquidité bancaire.
Recettes attendues des réformes : les gains commenceraient à se matérialiser progressivement dès 2026, pour atteindre un rythme annuel stable d’environ 10 milliards de dollars à partir de 2028, répartis entre élargissement de l’assiette fiscale (+3 milliards de dollars), économies nettes sur subventions (+2,5 milliards), gains en devises via exportations et substitution d’importations (+2,5 milliard), amélioration des entreprises publiques (+0,8 milliard) et autres gains structurels (+1,2 milliard), soit un total cumulé de 30 milliards de dollars sur 2028–2030.
Apport des réserves de change : les réserves de change pourraient baisser significativement, passant d’environ 60 milliards de dollars en 2024 à 12 milliards en 2030, limitant la capacité mobilisable à un plancher prudent, estimé autour de 15 milliards soit une marge nette effective d’environ 25 milliards de dollars à mobiliser entre 2026 et 2030 sans mettre en danger la stabilité externe.
Gap de financement : sur la période-clé de trois ans (2026–2028), le gap de financement total est estimé à 55 milliards de dollars, soit un besoin moyen d’environ 18 milliards par an, après prise en compte des réserves mobilisables (25 milliards) et des gains cumulés des réformes (30 milliards).
Sources possibles de financement et stratégie d’endettement claire. Dans le cadre de cette dernière qui est essentielle pour garantir la viabilité de la dette, optimiser le financement et renforcer la confiance des investisseurs, tout en accompagnant les réformes économiques, plusieurs formes de financement sont disponibles : (1) l’endettement intérieur, sans risque de change, qui favorise le développement du marché financier national encore peu mature mais nécessitant titrisation et modernisation des infrastructures ; (2) la finance islamique, avec l’émission de «sukuk» souverains visant à mobiliser une épargne locale et internationale spécifique ; (4) les créanciers multilatéraux et bilatéraux, dont les capacités restent limitées dans un contexte mondial contraint ;(5) l’endettement extérieur, qui permet de diversifier les sources, renforcer les réserves et créer une courbe souveraine sous réserve d’une gestion prudente du risque de change ; (6) le crédit syndiqué, option complémentaire pour financer des grands projets mais comportant des risques contractuels ; enfin (7) l’émission d’obligations souveraines internationales, nécessitant le développement des capacités de préparation, communication et notation pour améliorer la visibilité et l’accès aux marchés financiers mondiaux.