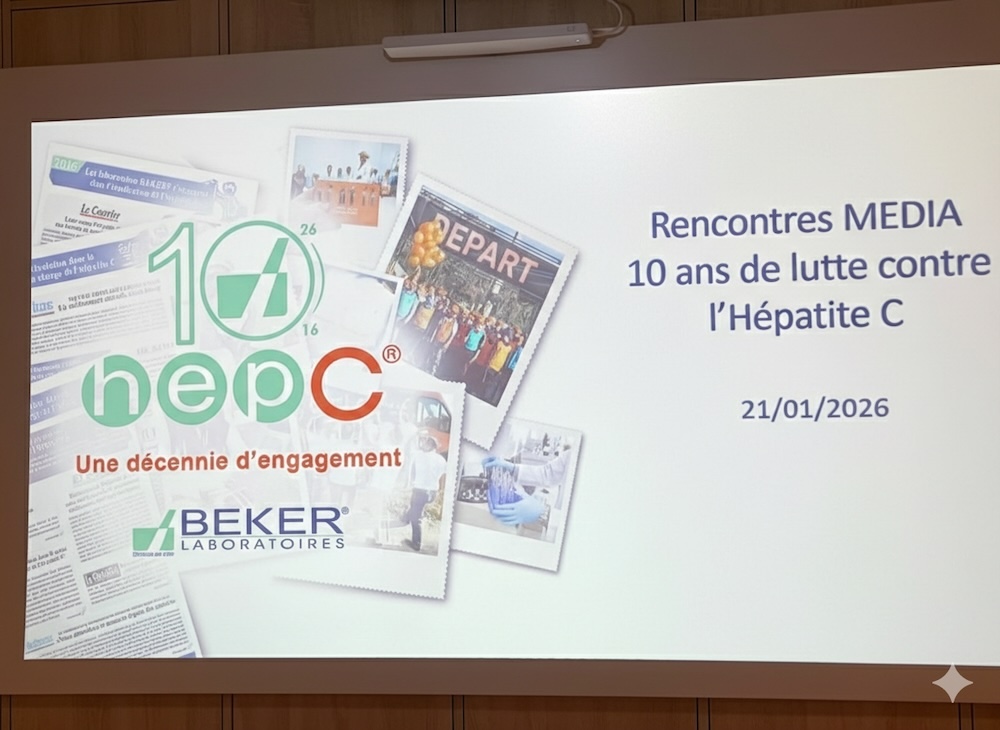Depuis Washington, l’administration américaine multiplie les pressions pour rapprocher l’Algérie et le Maroc dans les soixante prochains jours. L’objectif : arracher un compromis sur le dossier du Sahara Occidental avant la reconduction, encore incertaine, du mandat de la MINURSO (Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental), qui arrive à échéance fin 2025.
Dans ce contexte, la perspective, nourrie par la diplomatie de Trump, d’un mandat non renouvelé de la Minurso, si elle venait à être entérinée par la Russie et la Chine, signifierait la fin d’un soutien de l’ONU à un référendum d’autodétermination au profit du plan marocain de large autonomie au Sahara occidental. Ce serait un revers stratégique pour le Polisario et pour l’Algérie, son principal soutien. C’est là qu’intervient l’enjeu du gaz de schiste.
Un accord gazier en coulisses
Derrière les discussions politiques, un autre dossier avance discrètement : celui du gaz de schiste algérien. Les majors américaines ExxonMobil et Chevron mènent des négociations avancées avec Alger pour exploiter deux gisements non conventionnels aux promesses considérables.
Mais au-delà de la dimension énergétique, cet accord a une portée géopolitique. En scellant un partenariat stratégique avec l’Algérie, Washington cherche à renforcer son influence dans le Maghreb et à diversifier ses leviers régionaux avec comme enjeu principal la sécurisation des approvisionnements de l’allié européen.
Reste une question centrale : qui profite le plus de ce rapprochement ? Selon un article d’un média marocain, cet accord serait perçu par Alger comme un moyen de rééquilibrer la position américaine, devenue outrageusement favorable au Maroc à l’ère de l’administration Trump. L’un des axes de pression d’Alger, en contrepartie de l’entrée d’acteurs américains sur les gisements de gaz non conventionnels en Algérie, serait, à défaut de sauver le plan onusien d’autodétermination aujourd’hui dans l’impasse, d’obtenir plus de concessions sur le contenu de l’autonomie qui serait accordée aux Sahraouis sous souveraineté marocaine. Si les États-Unis pouvaient se présenter à Alger il y a dix ans comme un partenaire incontournable pour développer de nouvelles recettes d’exportations de gaz grâce à l’exploitation du non conventionnel, l’argument tombe aujourd’hui. Un nouvel acteur donne à l’Algérie une plus grande marge de manœuvre face à Washington et à sa diplomatie des « accords package ».
La Chine entre dans la partie
La donne se complique davantage avec l’arrivée du géant chinois Sinopec, qui a conclu un contrat avec Sonatrach pour l’exploration du bloc Guern El-Guessa II (36 000 km²) dans le bassin Gourara-Timimoune, riche en potentiel de schiste.
Pour Alger, ce partenariat vise à éviter une dépendance exclusive aux entreprises américaines et à accélérer la mise en valeur de ses ressources non conventionnelles.
La méthode chinoise séduit : expertise technique intégrée, flexibilité opérationnelle, et moindre exposition aux contraintes environnementales et sociales. Sinopec offre ainsi à l’Algérie un contrepoids stratégique face à Washington et un outil pour diversifier ses alliances sans rompre les équilibres régionaux. Mais surtout la Chine n’est pas dans un marchandage diplomatique voulant contraindre l’Algérie à renoncer au soutien à l’autodétermination du peuple sahraoui. Un virage que la légitimité poussive du pouvoir politique algérien rend encore plus compliqué a opérer même sous les plus fortes pressions américaines..
Atouts et défis algériens
L’Algérie demeure toutefois dans une position précaire. Elle cherche à relancer ses exportations de gaz naturel alors que l’Europe prévoit de réduire sa dépendance au gaz russe d’ici 2028. Le développement du schiste pourrait consolider la position d’Alger parmi les trois principaux fournisseurs du continent.
Cette ambition se heurte cependant à des obstacles majeurs : coûts d’investissement élevés, technologies de pointe encore limitées, et défi d’acceptabilité sociale dans les régions désertiques.
Avec des champs conventionnels vieillissants, comme Hassi R’Mel, et une transition énergétique encore balbutiante, le pari du schiste apparaît pour Alger moins comme un choix que comme une nécessité stratégique. La diversification des partenaires -entre Washington et Pékin- augmente la marge de manœuvre du pays, tout en rendant sa diplomatie énergétique plus complexe.
Vers un équilibre diplomatique
L’initiative américaine pour rapprocher Alger et Rabat s’accompagne d’une stratégie énergétique où le gaz de schiste algérien occupe une place clé. En ouvrant la porte à Exxon, Chevron et Sinopec, l’Algérie gagne en attractivité et renforce son rôle sur la scène internationale, tout en conservant une latitude politique sur le dossier sahraoui.
Les États-Unis, eux, obtiennent un nouveau levier d’influence dans le Maghreb et un argument supplémentaire dans leur politique de sécurisation énergétique transatlantique.
Le plan américain autour du Sahara occidental, adossé à un soutien à l’autonomie marocaine, s’inscrit désormais dans un cadre plus large : celui d’un équilibre géopolitique redessiné aussi par l’énergie.
Dans cette équation, le gaz de schiste algérien n’est plus un simple projet industriel. Il devient un instrument diplomatique majeur, au croisement des intérêts économiques, stratégiques et sécuritaires sur la rive sud de la Méditerranée.