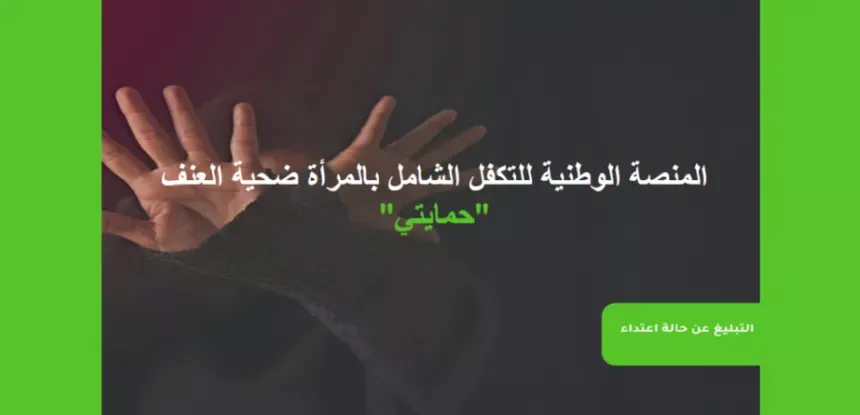315 féminicides documentés depuis 2019, 48 en 2024, 20 déjà recensés jusqu’en avril 2025. Face à cette réalité alarmante, l’Algérie lance sa première plateforme numérique nationale contre les violences de genre. Mais entre la promesse technologique et la protection effective, le chemin reste semé d’embûches.
“Himayati” (himayati.dz), lancée le 1er septembre, se présente comme la première plateforme nationale permettant aux femmes de signaler les violences et d’accéder aux services d’aide directement en ligne. Le ministère de la Solidarité nationale promet une “prise en charge complète” connectant police, justice et services de santé à travers tout le territoire.
Au-delà des annonces, les chiffres recensés par Féminicides Algérie font état de 48 féminicides en 2024 et de 315 depuis 2019 ; en 2025, le suivi au fil de l’eau fait état, à titre provisoire, de 20 féminicides recensés à fin avril, confirmant la persistance des violences.
Une technologie face aux barrières systémiques
L’initiative arrive à un moment où l’Algérie cherche à moderniser sa réponse aux violences de genre. Depuis 2015, la loi criminalise officiellement les violences conjugales et le harcèlement. Pourtant, une disposition problématique demeure : la “clause de pardon” qui permet aux victimes de retirer leurs plaintes, interrompant automatiquement les poursuites.
Cette clause, critiquée par les organisations de défense des droits des femmes, reflète une approche qui considère encore la violence domestique comme une “affaire privée” plutôt qu’un crime public. Résultat : même avec un nouveau canal de signalement, les victimes peuvent se retrouver dans l’impasse légale si elles changent d’avis sous pression familiale ou sociale.
“Un formulaire en ligne ne remplace pas un refuge sûr”, explique une militante du Réseau Wassila-Avife, qui accompagne les victimes depuis des années. L’organisation continue son travail d’aide juridique et psychologique, espérant que le gouvernement formalisera des liens avec la nouvelle plateforme.
Les promesses à l’épreuve du terrain
Le véritable test d’Himayati ne se trouve pas dans son interface utilisateur, mais dans sa capacité à mobiliser rapidement des ressources concrètes. Combien de temps s’écoulera entre un signalement et une intervention ? Combien de places d’hébergement d’urgence sont réellement disponibles ? Les forces de l’ordre ont-elles été formées pour traiter ces dossiers avec la gravité requise ?
Le gouvernement n’a pas encore publié d’indicateurs permettant de mesurer ces aspects opérationnels. Sans données sur les délais de réponse, les taux de placement en sécurité ou le nombre d’ordonnances de protection effectivement exécutées, l’impact réel reste difficile à évaluer.
Cette transparence est pourtant essentielle. Les organisations internationales comme ONU Femmes insistent sur trois piliers pour combattre efficacement la violence de genre : collecter les données, orienter les victimes et assurer leur protection. L’Algérie semble avoir abordé les deux premiers, mais le troisième demeure le plus ardu.
Un écosystème de soutien encore fragile
Au-delà de la plateforme gouvernementale, un réseau d’organisations indépendantes continue de documenter et combattre les violences. Féminicides Algérie maintient une veille statistique rigoureuse, conscient que ses chiffres – basés sur les sources publiques et médiatiques – ne reflètent qu’une partie de la réalité.
Ces groupes pourraient devenir des partenaires précieux d’Himayati, à condition que l’État reconnaisse formellement leur expertise et établisse des protocoles de collaboration. Pour l’instant, chaque organisation opère dans son domaine, sans coordination systématique.
Le succès d’Himayati dépendra aussi de la confiance que lui accorderont les femmes algériennes. Beaucoup hésitent encore à signaler les violences, craignant les représailles familiales, le jugement social ou l’inefficacité des institutions.
La plateforme numérique offre une certaine discrétion, permettant aux victimes de faire le premier pas depuis leur domicile. Mais cette facilité technique ne suffira pas si les étapes suivantes – enquête, protection, procédure judiciaire – reproduisent les dysfonctionnements habituels.
L’Algérie rejoint ainsi de nombreux pays qui expérimentent les outils numériques pour lutter contre la violence de genre. L’expérience internationale montre que la technologie peut améliorer l’accès aux services, mais qu’elle ne remplace jamais l’engagement politique et les ressources humaines nécessaires pour protéger réellement les victimes.