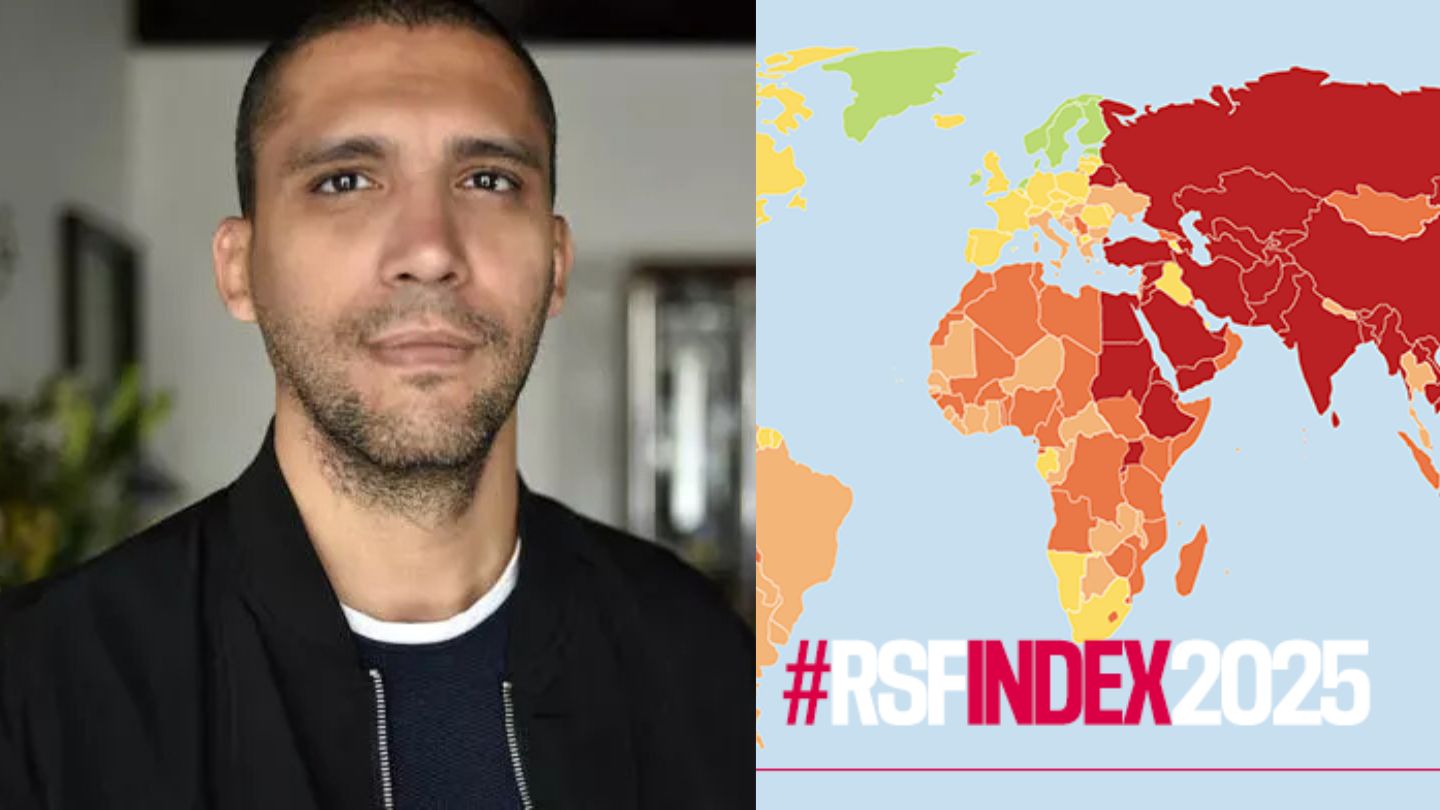Alors que RSF vient de publier son classement mondial 2025 de la liberté de la presse, Khaled Drareni, représentant de l’organisation en Algérie, revient pour Maghreb Emergent sur la situation contrastée des pays du Maghreb, entre recul notable de la Tunisie et légères progressions de l’Algérie et du Maroc.
Pour commencer, pouvez-vous nous dresser un panorama de la situation ? Le classement RSF 2025 semble montrer une détérioration générale de la liberté de la presse au Maghreb. Quelles sont les principales menaces politiques et économiques qui pèsent aujourd’hui sur les médias de la région ?
Khaled. D: Les principales menaces politiques sont évidemment les pressions qui peuvent s’exercer de manière continue contre les journalistes et les menaces qu’ils reçoivent de manière permanente dans certains pays, en plus de législations qui parfois peuvent être considérées comme un obstacle à la pratique d’un journalisme libre et indépendant.
L’indicateur économique du Classement mondial de la liberté de la presse continue de chuter en 2025 et atteint un niveau critique inédit. Conséquence : pour la première fois, la situation de la liberté de la presse devient « difficile » à l’échelle du monde.
L’indicateur relatif aux contraintes économiques pesant sur les médias et aux conditions financières du journalisme est, parmi les cinq indicateurs qui composent le Classement mondial de la liberté de la presse, le principal facteur qui tire vers le bas le score global des pays en 2025.
Les menaces économiques restent les mêmes dans tous les pays de la région avec un modèle traditionnel de publicités qui a montré ses limites et qui empêche le développement des médias et la pérennisation des emplois des journalistes.
Le renforcement du pouvoir de l’actuel président dès l’été 2021 et le gel du Parlement ont impacté fortement sur les libertés publiques, dont celle de la presse en particulier.
Khaled Drareni
Vous évoquez ces pressions généralisées, mais il y a visiblement des situations plus critiques que d’autres. Dans ce classement, la Tunisie, autrefois considérée comme un modèle régional, connaît une chute brutale de 11 places. Comment expliquez-vous ce recul spectaculaire et quelles en sont les conséquences concrètes pour les journalistes tunisiens ?
Kh. D : Les pressions financières impactent les médias, notamment en Tunisie (129e), pays qui perd donc onze places et enregistre la plus forte baisse du score économique de la région (- 30 places sur ce volet), dans un contexte de crise politique où la presse indépendante est prise pour cible.
Le renforcement du pouvoir de l’actuel président dès l’été 2021 et le gel du parlement ont impacté fortement sur les libertés publiques, dont celle de la presse en particulier. Nous enregistrons aujourd’hui trois journalistes en détention, à savoir Chedha Haj Mbarek, Borhene Bsaies et Mourad Zeghidi. Tous incarcérés de manière injuste et arbitraire. Cette escalade envers les médias et ces arrestations en cascade ont naturellement influé sur le classement de la Tunisie et fait peser des menaces sérieuses sur l’exercice du journalisme dans le pays.
Ce qui est frappant dans ce classement, c’est le contraste entre la Tunisie et ses voisins. Alors que la Tunisie régresse, l’Algérie et le Maroc progressent respectivement de 13 et 9 places. Comment interprétez-vous cette évolution contradictoire ? S’agit-il d’une réelle amélioration de la situation des journalistes dans ces deux pays ?
Kh. D : L’Algérie et le Maroc ont progressé dans le classement, cela s’explique surtout par la libération au cours de l’année 2024 des journalistes dans ces deux pays. Omar Radi, Soulaimane Raissouni, et Taoufik Bouachrine graciés par le roi Mohamed VI en juillet, et Ihsane El Kadi en Algérie gracié le 1er novembre de la même année par le président Tebboune. Le Maroc a progressé de neuf places, passant de la 129e place dans le classement à la 120e, et l’Algérie de 13 places, passant de la 139e place à la 126e.
Cette progression de ces deux pays n’enlève en rien au caractère toujours compliqué de l’exercice du journalisme et de la liberté de voyager des journalistes libérés qui restent injustement restreinte.
Vous avez mentionné le cas de trois journalistes tunisiens actuellement en détention. Parmi les cas d’incarcération récents, celui de Chadha Hadj Mbarek a été largement médiatisé. En revanche, Abdelwakil Blamm, dont RSF a également dénoncé la détention, n’apparaît pas dans votre rapport. Pourquoi cette différence et, plus largement, quels critères utilisez-vous pour mettre en lumière certains cas plutôt que d’autres ?
Kh. D : RSF a été la première et la seule organisation de défense des journalistes à dénoncer l’arrestation de Abdelwakil Blamm, et cela quelques heures après les faits. Nous continuerons toujours à le faire et à le défendre jusqu’à ce qu’il retrouve les siens et recouvre sa pleine liberté. Pour cela, l’organisation maintient un contact permanent avec ses avocats et se tient informée du déroulé de cette affaire. Le classement annuel ne mentionne pas toujours les journalistes incarcérés mais se focalise davantage sur la situation générale dans le pays et l’état des différents indicateurs.
Au regard de l’engagement de RSF pour Abdelwakil Blamm évoqué en fin d’entretien, on constate à quel point la situation au Maghreb demeure complexe : des avancées fragiles en Algérie et au Maroc contrastent avec le recul alarmant de la Tunisie. Derrière les classements se cachent des réalités humaines, tandis que les pressions économiques deviennent la menace principale pour la liberté de la presse dans toute la région. Ce panorama contrasté nous rappelle que la vigilance reste de mise face aux multiples obstacles qui entravent encore l’exercice d’un journalisme libre et indépendant.