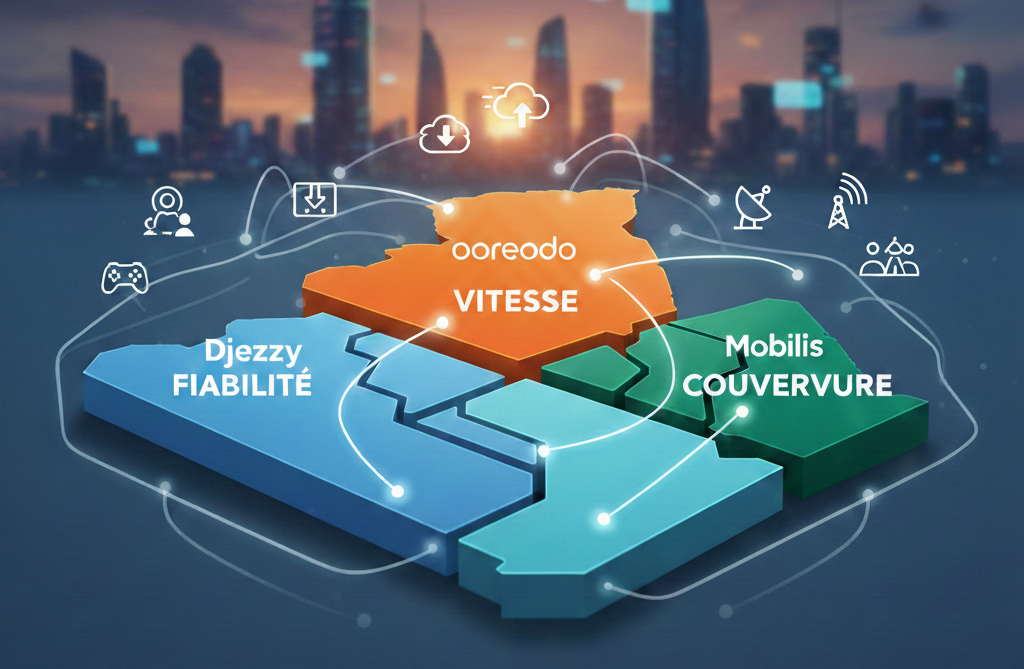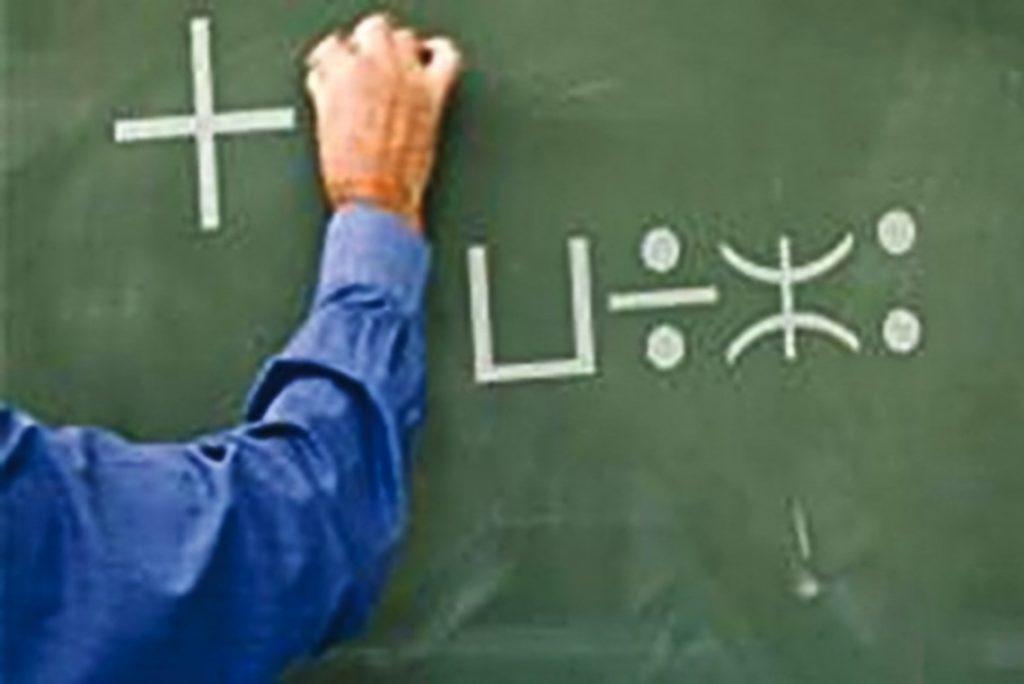En décidant d’augmenter sa production à partir de novembre 2025, l’OPEP+ prend le contrepied d’un marché stable et d’une demande en repli. Le cartel cherche à affirmer son influence face à la concurrence, au risque de brouiller la lecture des signaux économiques.
L’OPEP+ a annoncé, dimanche 5 octobre, qu’elle augmenterait sa production de pétrole à compter du mois de novembre 2025. Le cartel, longtemps perçu comme le garant d’un équilibre fragile entre l’offre et la demande, infléchit ainsi sa stratégie au moment même où le marché reste stable, les stocks limités et la demande mondiale en perte de vitesse. Cette décision, modeste dans son volume mais lourde de portée, brouille davantage la lecture des signaux économiques.
Après une longue séquence de restrictions volontaires destinées à soutenir les prix, la coalition opte cette fois pour une inflexion qu’on peins à interpréter. Les fondamentaux ne plaident pourtant pas pour une détente. Les prévisions de croissance restent prudentes, la consommation industrielle fléchit et les marges de raffinage se resserrent.
En relançant la production, l’OPEP+ semble surtout vouloir marquer son territoire face à la concurrence croissante des producteurs indépendants, des États-Unis au Brésil, qui profitent d’un environnement de prix encore rémunérateur pour gagner des parts de marché.
L’organisation met en avant la “solidité des fondamentaux” et le “niveau faible des stocks” pour justifier sa décision. Mais cette rhétorique contraste avec la nervosité des marchés, ébranlés par les incertitudes macroéconomiques et les tensions géopolitiques.
L’ajustement annoncé -environ 4 000 barils supplémentaires par jour pour l’Algérie -apparaît finalement plus politique qu’économique, cherchant avant tout à afficher une cohésion de façade entre les membres tout en préservant la rente pétrolière à court terme.
Une décision en décalage avec le temps de la transition
En arrière-plan, la mesure résonne avec une autre temporalité, celle de la transition énergétique. À quelques semaines de la COP30, où doit être débattu le financement des énergies fossiles, cette décision renvoie l’image d’un secteur encore prisonnier de ses réflexes d’abondance. Les grandes économies, de leur côté, réaffirment leurs objectifs de sobriété, tandis que les investisseurs déplacent leurs capitaux vers les technologies bas carbone. L’Agence internationale de l’énergie prévoit désormais un plafonnement de la demande pétrolière d’ici à 2027.
Cette juxtaposition de dynamiques opposées-expansion de l’offre d’un côté, ralentissement structurel de la demande de l’autre -souligne le décalage croissant entre la logique des producteurs et les priorités climatiques mondiales.
Pour les pays membres, à commencer par l’Algérie, cette augmentation, même limitée, prolonge une dépendance au brut difficile à rompre, tout en maintenant un discours de diversification encore peu concret. À mesure que la transition s’accélère, ce déséquilibre devient plus perceptible et interroge la capacité du modèle pétrolier à se réinventer sans s’épuiser.