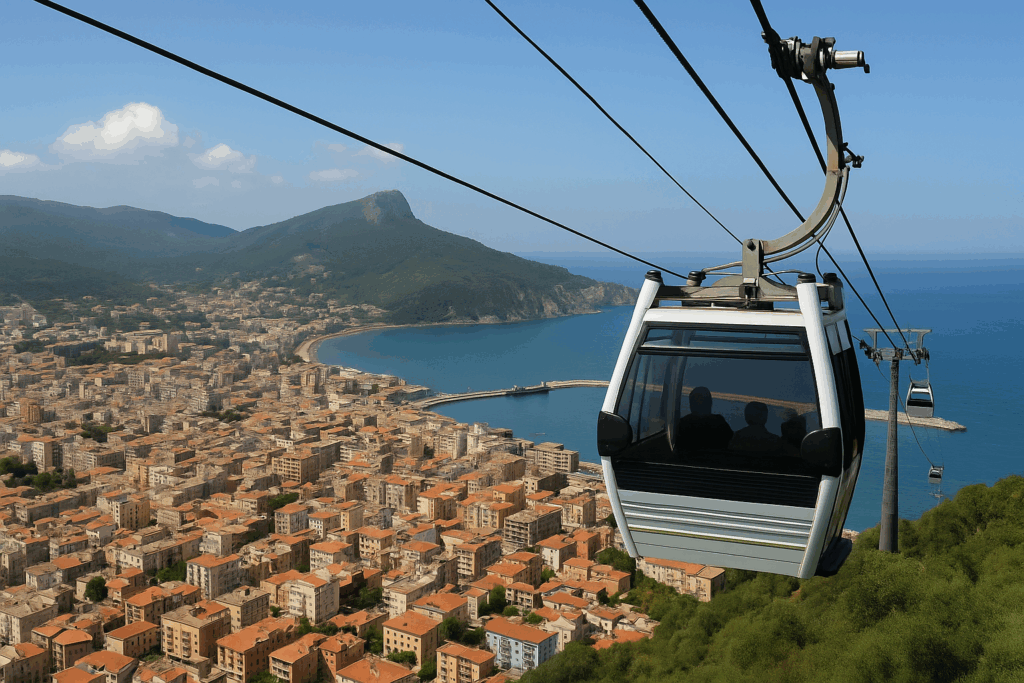Un article paru sur Maghreb Émergent le 15 de ce mois, repris ensuite par plusieurs médias, annonce que l’Algérie s’apprête à conclure un accord majeur avec deux géants américains : Exxon Mobil et Chevron. Plus récemment encore, d’autres compagnies américaines, parmi lesquelles Schlumberger, Halliburton, PetroOxy, lorgnent sur les richesses en hydrocarbures du sous-sol algérien, et notamment sur le très controversé gaz de schiste.
Cette perspective soulève une multitude de questionnements, comme le rappelle à juste titre notre ami Saad Kermiche, du Canada. Il souligne que l’extraction du gaz de schiste est loin d’être aussi rentable en Algérie qu’aux États-Unis, et ce pour plusieurs raisons objectives :
Le coût d’un puits : pour être rentable, il ne devrait pas dépasser 6 à 7 millions de dollars aux États-Unis, alors qu’en Algérie il atteindrait jusqu’à 20 millions de dollars.
L’eau et l’environnement : il faudrait creuser simultanément des milliers de puits, compte tenu des quantités phénoménales d’eau nécessaires à la fracturation hydraulique. Or, si l’on intègre sérieusement les préoccupations environnementales, les coûts grimperaient encore.
Le facteur temps : entre la phase d’exploration et celle d’exploitation, il peut s’écouler près de 10 ans. Dans cet intervalle, les énergies renouvelables progressent rapidement et pourraient rendre ce choix obsolète.
La sécurité au Sud : la situation sécuritaire instable pourrait décourager les compagnies, malgré les intérêts économiques en jeu.
Saad Kermiche conclut que le pouvoir fait une lecture erronée de la situation actuelle et future, et qu’il hypothèque nos ressources en échange du soutien extérieur nécessaire à sa survie politique.
Permettez-moi de lui répondre avec humilité.
La rentabilité d’un puits en Algérie ne peut être comparée mécaniquement à celle des États-Unis : Le coût de l’eau, par exemple, est bien plus faible grâce à l’exploitation de la nappe albienne. Il est probable que des garanties sur son prix aient déjà été données aux compagnies, réduisant d’autant un poste majeur de dépenses.
Quant aux milliers de puits nécessaires, la zone saharienne est immense, sans contraintes urbanistiques, ce qui facilite l’installation à grande échelle. Les préoccupations environnementales ? Permettez-moi d’en douter : non seulement elles seront ignorées, mais certains produits chimiques interdits ailleurs risquent d’être utilisés en toute impunité.
Le gaz et pétrole de schiste ainsi obtenus seront principalement destinés à l’Europe, voisine et grand consommatrice, ce qui réduira considérablement les coûts de transport. De plus, la qualité du gaz saharien, jugée meilleure, nécessiterait moins de raffinage, donc plus rentable.
Concernant le délai de 10 ans avant exploitation, il resterait à vérifier si les études exploratoires n’ont pas déjà fortement avancé depuis 2014–2015.
Quant à la sécurité, rappelons qu’au plus fort de la décennie noire, les compagnies étrangères ont toujours réussi à protéger leurs infrastructures, à l’exception de l’attentat de Tigantourine. Dès lors, tant que les profits sont au rendez-vous, cela ne semble pas un obstacle majeur.
L’exploitation de l’albien
La nappe albienne couvre 70% du territoire algérien. Ses réserves sont estimées entre 30 000 et 50 000 milliards de m³. En proportion, nos propres ressources s’élèveraient à 21 000 – 35 000 milliards de m³. Un réservoir colossal, que les observations satellitaires de la NASA et les études de l’Observatoire du Sahara et du Sahel considèrent comme partiellement renouvelable : environ 1,4 milliard de m³/an, contre un pompage actuel de 2,7 milliards. Nous consommons donc plus du double de ce qui se renouvelle naturellement.
La consommation annuelle totale d’eau en Algérie était estimée en 2024 à près de 11 milliards de m³ (eau potable, agriculture, industrie). Rapportée aux réserves, cela paraît gigantesque – plusieurs millénaires d’autonomie théorique. Mais cette vision est trompeuse. La réalité est que nos besoins sont déjà trois fois supérieurs à ce qui est distribué, et que la qualité de cette nappe risque d’être irrémédiablement compromise par la pollution. L’exemple de Haoud Berkaoui illustre parfaitement ces dérives : pollution par les opérations d’extraction, remontée saline, effondrement de terrains – et aucune prise en charge sérieuse des dégâts.
Ajoutons à cela l’installation de fermes agricoles géantes dans le Sud. Comme l’explique le chercheur algérien Dr Rabah Lahmar dans son article « Comment désertifier un désert », les rendements spectaculaires des premières années chutent rapidement : les eaux albiennes sont salées, et sans systèmes de drainage adéquats, les sels s’accumulent et stérilisent irrémédiablement les sols. L’Arabie saoudite en a déjà fait la triste expérience.
Or, l’exploitation du gaz de schiste accentue encore cette menace. Les chiffres sont sans appel : 15 000 m³ d’eau pour une seule fracturation ; plusieurs fracturations par puits ; environ 1 500 puits nécessaires pour une exploitation rentable.
On imagine donc les volumes astronomiques pompés dans l’albien. Le danger le plus grave reste cependant la pollution chimique, quasi irréversible. Aux États-Unis, un seul puits a déjà contaminé des nappes sur plusieurs kilomètres, entraînant le déplacement de populations expropriées, des séismes liés à la fragilisation du sous-sol et une explosion des maladies liées à l’eau. Et rappelons-le : la durée de vie d’un puits de schiste dépasse rarement 5 ans… laissant le territoire criblé comme un gruyère.
Conclusion
L’exploitation du gaz de schiste ne s’annonce pas comme un moteur de développement, mais bien comme une extension du système rentier et une fuite en avant d’un pouvoir en quête de survie. Cette logique met en péril deux enjeux existentiels :
La dilapidation de nos ressources stratégiques : nappe albienne, hydrocarbures, terres sahariennes, mines…
La destruction de notre environnement et la santé des populations.
Dans un monde qui accélère sa transition vers les énergies renouvelables, alors que l’Algérie dispose d’un potentiel immense en solaire, engager l’avenir du pays dans un pari sur les énergies fossiles est une erreur historique.