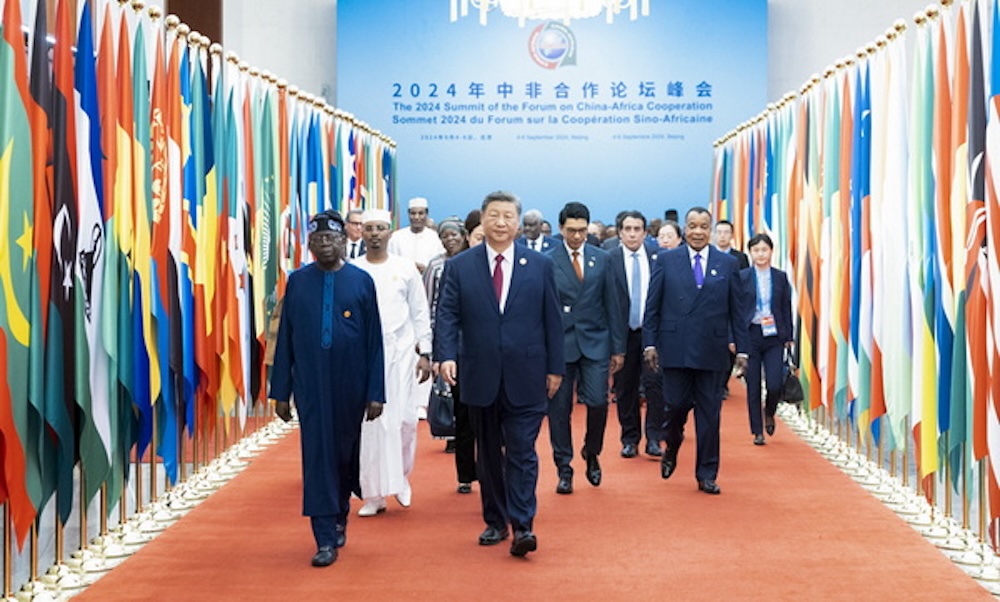Dans cet entretien accordé à Maghreb Émergent, le professeur et sociologue Nacer Djabi livre une analyse approfondie du phénomène de l’immigration clandestine, connu sous le nom de « el harga ». Il revient notamment sur l’épisode marquant où sept mineurs algériens ont pris un yacht depuis la côte est d’Alger, avant de rejoindre, au terme de neuf heures de traversée, les rivages espagnols.
ME : Est-ce que vous avez suivi l’histoire des enfants mineurs qui sont partis en Espagne en bateau, disant qu’ils l’avaient volé eux-mêmes ?
Nacer Djabi : Dans cette affaire, il y a les événements liés à l’incident lui-même, et aussi des dimensions de long terme.
Ce qui est nouveau cette fois-ci, c’est que ces jeunes sont mineurs, et qu’il s’agit d’un groupe d’amis du quartier.
Cela confirme ce que j’ai répété plusieurs fois : la « harga » depuis des années n’est plus un projet individuel, c’est devenu un projet collectif, qui peut même concerner la famille entière.
Autre élément, c’est que cela s’est passé à Tamnfoust, une zone côtière où les jeunes sont habitués à la mer, qui n’est pas un univers inconnu pour eux. Ils savent souvent piloter le bateau.
Ce phénomène se retrouve sur tout le littoral algérien, de Annaba à Tipaza.
Donc, concernant l’événement, il y a des éléments de contexte local, mais en général, cela s’inscrit dans une tendance qui existe depuis des années, et qui s’aggrave avec la météo favorable.
Mais en profondeur, les causes profondes demeurent et risquent de durer des années.
Il semble même que les autorités ne s’en préoccupent plus beaucoup : elles ont, en quelque sorte, abandonné – elles reconnaissent implicitement qu’elles n’ont pas de solution.
Si de tels cas survenaient dans d’autres pays, des mineurs migrants ainsi, ce serait un scandale national.
Aujourd’hui, tout est filmé, partagé : j’ai vu des vidéos où la barque accoste en Espagne.
ME : Qu’entendez-vous par projet collectif ? Ces jeunes sont aidés par leur familles et proches pour traverser la mer à bord de bateaux de fortune ?
Nacer Djabi : Au début, quand le phénomène a explosé, on disait : la mère ne sait pas, le père pas au courant, les frères le cherchent… Mais aujourd’hui, tout indique que ce n’est plus exact : c’est devenu un projet familial, auquel contribuent sœurs, frères, voisins du quartier.
C’est devenu une forme de sauvetage. Ils envoient un membre pour les sauver, pour sortir de cette situation – y compris par soutien financier ou moral.
Pour ceux qui restent en Algérie, la « harga » ressemble à une aventure risquée, qui peut échouer ou se terminer par la mort, ce qui est malheureux.
Mais pour ces jeunes, c’est un acte de sauvetage, une aventure, mais une opération pour se sauver eux-mêmes.
D’ailleurs, le climat de départ ressemble plus à une fête qu’à un enterrement : cortège, musique, chants, danses. Pas de tristesse ou de peur : c’est comme un mariage.
ME : Qu en est il des autorités ? vous dites qu’ elles n’ont plus de sollutions. Vous voulez dire que la situation echape meme au plan securita ire?
Les autorités n’ont ni solutions sécuritaires ni économiques pour contrôler la situation. Elles ne sont pas en mesure, aujourd’hui, d’apporter de vraies réponses.
La « harga » ne concerne pas que l’économie ou l’emploi : c’est la quasi-totalité des problèmes des jeunes Algériens qui y convergent.
Les préoccupations des jeunes ne sont pas seulement économiques, elles concernent aussi un idéal de vie différent, un mode de vie européen, même si cet idéal ne se réalisera peut-être jamais.
Les pouvoirs publics ont longtemps parlé de lutte contre le chômage, mais même si un jeune reçoit un salaire, cela lui suffit-il ? Le rêve de vivre ici n’existe plus.
Ce qui est dangereux, c’est que ces jeunes ne voient plus leur avenir lié au pays : il y a une rupture, une déconnexion. Pour ces jeunes, l’avenir est ailleurs, même au risque de leur vie.
ME : le phénomène nous interpelle tous dans ce cas, car il s’agit maintenant d’enfants mineurs. N’est pas ?
Nacer Djabi : La responsabilité est collective : famille, individu, État, élites, tout le monde doit se sentir concerné.
Le phénomène a une dimension globale, il ne porte pas seulement sur l’économie, la société ou la sécurité : il exige des remises en question profondes pour que la jeunesse retrouve confiance dans le pays.
Dans les années 1970-80, ceux qui partaient à l’étranger gardaient le lien avec l’Algérie, persuadés que leur destin restait lié à celui du pays, à sa situation politique et économique, à leur famille.
Ce lien s’est perdu : aujourd’hui, les jeunes veulent tout, tout de suite, et pensent qu’ils ne pourront jamais l’avoir ici, en Algérie.
Ils veulent changer de vie – changer de monnaie, de conditions de vie, de libertés individuelles, de rapports femmes-hommes, de fêtes…
Le paradoxe, c’est qu’ils gardent parfois un visage conservateur à l’intérieur, mais rêvent d’un mode de vie occidental, laïc, où les libertés et la mixité sont la norme.
Ce sont ces contradictions que révèle la « harga », qui n’est pas seulement un problème matériel ou social : les jeunes s’y engagent avec toute leur complexité, tous leurs désirs, toutes leurs contradictions.