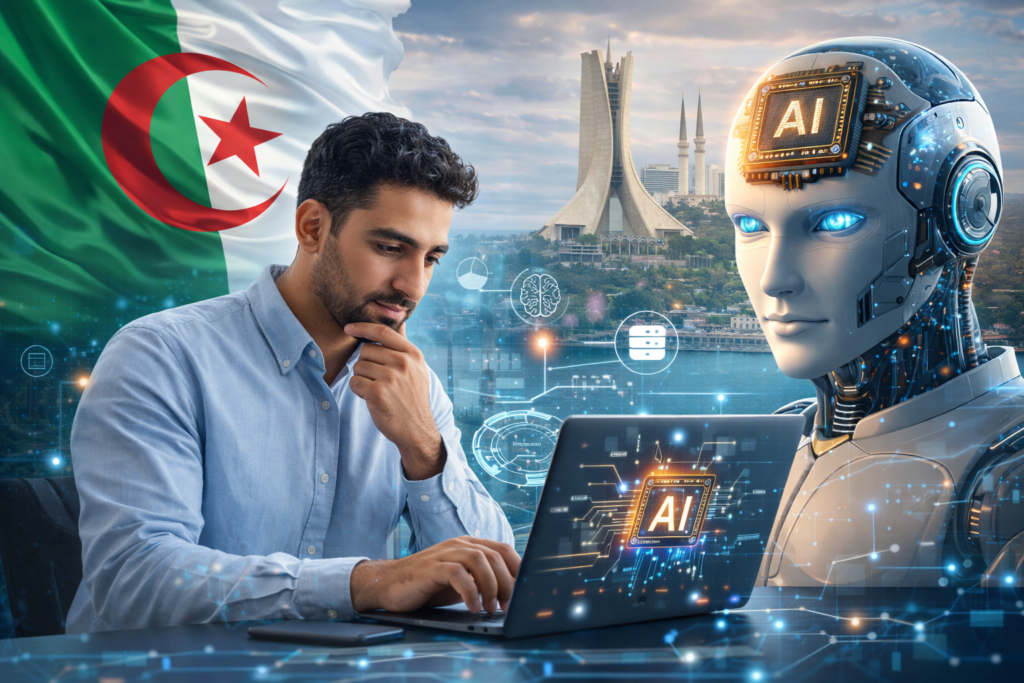Fini le temps où seuls les derniers maillons de la chaîne payaient l’addition. Du maître d’ouvrage à l’auto-école, tous dans le viseur de la justice. Une révolution juridique qui promet la rigueur… mais pourrait paralyser l’action. Entre effet dissuasif et spirale contentieuse, l’Algérie teste un progrès à double tranchant.
Réuni en comité restreint ce mardi 26 août sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement a décidé d’élargir la chaîne des responsabilités juridiques dans les catastrophes routières et d’infrastructures. Désormais, ne seront plus concernés uniquement les chauffeurs ou exploitants directs, mais aussi les maîtres d’ouvrage, les entreprises de réalisation, les directions des travaux publics, les organismes de contrôle technique et même les auto-écoles.
Cette décision intervient à la suite du drame d’Oued El Harrach, qui a révélé avec brutalité les failles de la sécurité routière et de la maintenance des équipements publics. L’exécutif affiche la volonté de rompre avec une logique de réparation financière après coup, pour instaurer une logique de responsabilité en amont.
Les effets attendus : rigueur et transparence
Une telle extension des responsabilités comporte d’abord des promesses positives. En mettant l’ensemble des maillons de la chaîne sous la menace d’éventuelles poursuites, le gouvernement espère provoquer un sursaut de vigilance. Les maîtres d’ouvrage seraient plus attentifs aux cahiers des charges, les entreprises plus rigoureuses dans la qualité des matériaux, les directions publiques plus strictes dans la surveillance, et les organismes de contrôle plus indépendants dans leurs rapports.
Cette « responsabilisation élargie » peut aussi permettre une meilleure traçabilité des défaillances. Lorsqu’un accident survient, la justice aurait la possibilité de remonter plus haut et d’identifier les causes structurelles, plutôt que de se limiter au dernier maillon, souvent le chauffeur. À terme, l’effet dissuasif pourrait contribuer à réduire le nombre de véhicules vétustes en circulation, améliorer la maintenance des routes et imposer de nouveaux standards de sécurité.
Le revers de la médaille : peur, contentieux et coûts
Mais la médaille a son revers. L’histoire des grandes réformes de responsabilité montre qu’une telle extension peut provoquer des effets inattendus.
D’abord, la peur du risque pénal peut paralyser les acteurs publics comme privés. Un ingénieur ou un directeur de travaux, craignant d’être poursuivi pour négligence, pourrait refuser de signer la réception d’un chantier, même conforme, ce qui retarderait la livraison des infrastructures.
Ensuite, la multiplication des responsabilités alourdit le climat contractuel. Les entreprises réclameront des clauses de garantie supplémentaires, les assurances augmenteront leurs primes, et certains acteurs pourraient se détourner de projets jugés trop risqués. Le résultat, paradoxalement, pourrait être une augmentation des coûts et des délais dans un pays où l’urgence de moderniser les infrastructures est pressante.
Enfin, l’extension des responsabilités risque d’enclencher une spirale de contentieux. Chaque acteur poursuivi cherchera à se défausser sur un autre : maître d’ouvrage contre entreprise, entreprise contre direction des travaux publics, direction contre organisme de contrôle. Ces batailles judiciaires absorberaient du temps et des moyens au détriment des solutions rapides pour sécuriser les routes et les ouvrages.
Ce que nous enseigne l’étranger : de Gênes à Brumadinho
L’Algérie n’est pas seule face à ce dilemme. Ailleurs, les grandes catastrophes ont débouché sur des extensions similaires de responsabilité.
En Italie, après l’effondrement du pont Morandi à Gênes en 2018, qui fit 43 victimes, un procès fleuve a été ouvert contre 59 dirigeants, ingénieurs et fonctionnaires. En 2024, un premier jugement a condamné 18 ex-responsables de la société concessionnaire Autostrade per l’Italia. L’affaire a profondément transformé la gestion des concessions autoroutières et renforcé les obligations de maintenance.
Au Brésil, l’effondrement du barrage de Brumadinho en 2019 a conduit à l’inculpation de l’ex-PDG de la compagnie minière Vale et de plusieurs cadres pour homicides multiples. Mais les procédures, longues et complexes, illustrent la difficulté d’établir la responsabilité pénale au sommet de grandes entreprises.
Au Bangladesh, l’effondrement du Rana Plaza en 2013 – plus de 1 100 morts – a conduit à des poursuites pour meurtre contre le propriétaire de l’immeuble et certains responsables administratifs. Là encore, les procès durent depuis des années.
Ces exemples montrent que la menace pénale atteint bel et bien les hauts responsables, mais que l’effet durable se mesure moins dans les tribunaux que dans l’évolution des normes : après Gênes, les inspections de viaducs se sont multipliées ; après Brumadinho, la surveillance des barrages a été renforcée ; après Rana Plaza, la filière textile mondiale a été contrainte à davantage de transparence.
Leçons sur la longue durée
L’expérience internationale enseigne que la judiciarisation ne suffit pas. Les procès s’étalent souvent sur dix ans, avec des acquittements, des prescriptions ou des condamnations parfois symboliques. Mais dans le même temps, la peur d’une nouvelle tragédie pousse les États à renforcer la réglementation, et les entreprises à améliorer leurs pratiques. C’est dans ce double mouvement – sanction et réforme – que se trouvent les véritables effets positifs.
Et en Algérie demain ?
En Algérie, une réforme s’imposait déjà après la rupture d’une balustrade au stade du 05 juillet d’Alger, le 21 juin dernier ( 6 morts, 79 blesses). La décision du 26 août ouvre une nouvelle ère, mais beaucoup dépendra du travail du législateur. Si les textes restent flous, les tribunaux seront submergés sans résultats concrets. S’ils sont précis, transparents et appliqués de façon cohérente, ils pourraient enclencher un cercle vertueux d’amélioration.
Les défis sont énormes : chaque jour, des accidents mortels surviennent à cause du mauvais état des routes, du manque de signalisation autour des chantiers, de la vétusté des véhicules. L’extension des responsabilités ne suffira pas si elle n’est pas accompagnée de budgets de maintenance, de formation et de contrôle.
La problématique est désormais politique autant que juridique : les Algériens saisiront-ils cette nouvelle possibilité de poursuite pour exiger des comptes aux responsables ? Ou bien le pouvoir continuera-t-il à répondre aux drames par des indemnisations rapides et populistes, sans s’attaquer aux causes structurelles ? La réponse appartient désormais à la société autant qu’à la justice.