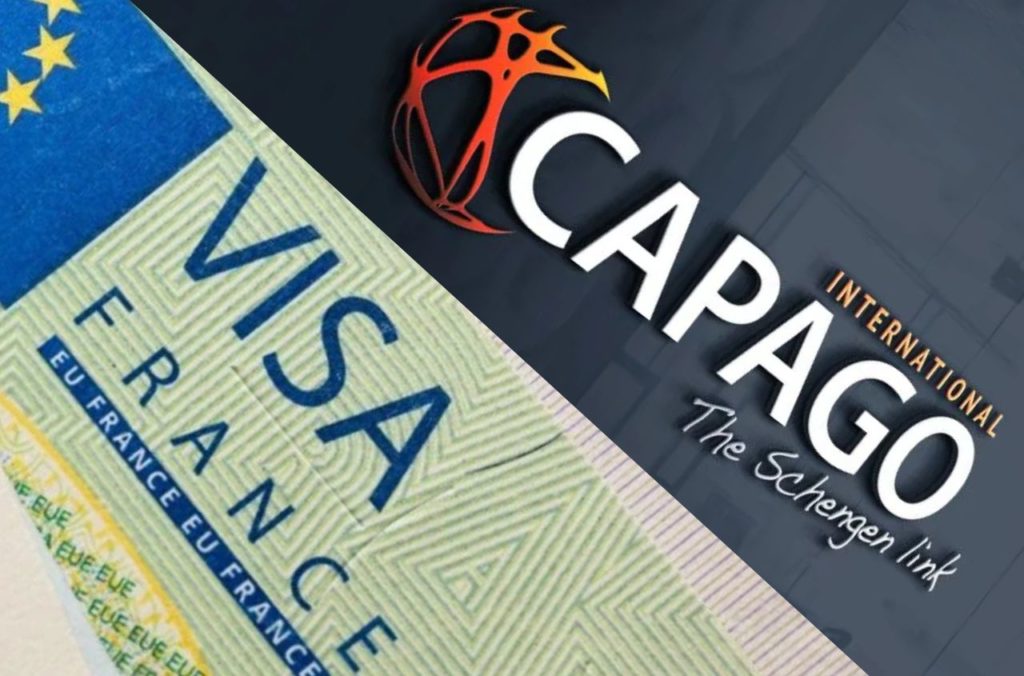Depuis dimanche 24 août, les transporteurs privés de Constantine observent une grève qui paralyse le réseau urbain. Au cœur du conflit : la flambée des prix des pneus et des pièces de rechange, désormais introuvables sur le marché. Cette situation, loin d’être une surprise, s’inscrit dans une crise structurelle que l’Union nationale des transporteurs (UNAT) dénonçait déjà publiquement en 2024.
Dès le mois de janvier 2024, l‘UNAT tirait la sonnette d’alarme dans un communiqué : “Trouver un pneu de bus sur le marché est devenu un véritable casse-tête pour les transporteurs. Des bus sont à l’arrêt, car leurs propriétaires ne trouvent pas de pneus sur le marché”. L’organisation professionnelle alertait alors sur le risque de “crise du transport dans le pays” si la situation persistait. Force est de constater que cette prédiction se réalise aujourd’hui à Constantine.
Les restrictions d’importation créent la pénurie
L’origine de cette pénurie n’a rien de mystérieux. L’UNAT l’expliquait clairement en 2024 : les restrictions imposées à l’importation par le gouvernement “en vue d’encourager la production nationale et de lutter contre la surfacturation des importations” ont créé un effet pervers. Cette mesure “déstabilise le marché et crée des pénuries, favorise la hausse des prix et la spéculation.”
À Constantine, cette pénurie frappe un parc déjà fragile. Selon la direction des Transports de la wilaya, 503 bus sur 3 142 dépassent les trente ans d’âge, soit 15% du parc. Ces unités vieillissantes nécessitent un entretien constant et des pièces spécifiques, rendues rares par la politique d’import-substitution. La dégradation du réseau routier accélère l’usure, créant un cercle vicieux où les besoins en maintenance explosent précisément quand l’approvisionnement se tarit.
Ce cercle vicieux expose l’incohérence de la politique gouvernementale : encourager une production nationale de pneus de bus qui n’existe pas tout en laissant 3 142 véhicules dépendre entièrement de ces équipements.
L’État exige le renouvellement du parc sans moyens
L’absurdité de la situation atteint son paroxysme avec l’exigence gouvernementale de renouvellement des flottes dans un délai de six mois. Après la tragédie d’El Harrach, l’État impose le retrait programmé des véhicules de plus de trente ans, suivi de ceux de plus de vingt ans. Cette décision sécuritaire légitime se heurte à une réalité économique implacable : comment exiger un renouvellement de parc quand les transporteurs ne peuvent déjà plus maintenir leurs véhicules existants ?
Les professionnels du secteur se retrouvent dans une impasse : impossibilité technique de prolonger la vie de leurs bus faute de pièces, et obligation réglementaire d’investir dans de nouveaux équipements alors même que l’UNAT réclamait déjà en 2024 “la révision à la hausse des tarifs du transport, car ils ne couvrent plus les charges des transporteurs.”
Face à ces restrictions, les acteurs ont développé des stratégies de contournement. L’UNAT documentait en 2024 l’émergence d’un “marché spécialisé dans l’importation en noir des pièces d’occasion de France. Des Algériens établis en France et en Espagne importent des pièces détachées”. Ce marché parallèle, symptôme de l’échec de la politique officielle, illustre la capacité d’adaptation du secteur privé face aux dysfonctionnements administratifs. Cette économie souterraine soulève une question fondamentale : pourquoi contraindre les transporteurs à des circuits d’approvisionnement hasardeux quand des solutions légales existent ?
Le service public résiste, le privé s’arrête
La grève de Constantine révèle par contraste la stabilité relative du service public. Seuls les bus bleus de l’ETUC continuent d’assurer les dessertes principales, bénéficiant d’une logistique d’approvisionnement plus sécurisée et de moyens financiers moins volatils.
Cette différence interroge la pertinence du modèle actuel : peut-on confier un service public essentiel à des opérateurs privés soumis à des restrictions d’approvisionnement que l’État impose tout en exigeant d’eux une modernisation accélérée ?
La crise actuelle n’est pas conjoncturelle mais structurelle. Elle résulte de décisions politiques contradictoires prises sans évaluation de leurs conséquences pratiques sur un secteur vital pour l’économie urbaine. Les alertes de l’UNAT en 2024 auraient dû déclencher une révision de cette approche. Leur non-prise en compte conduit aujourd’hui à la paralysie que l’organisation professionnelle avait prédite.