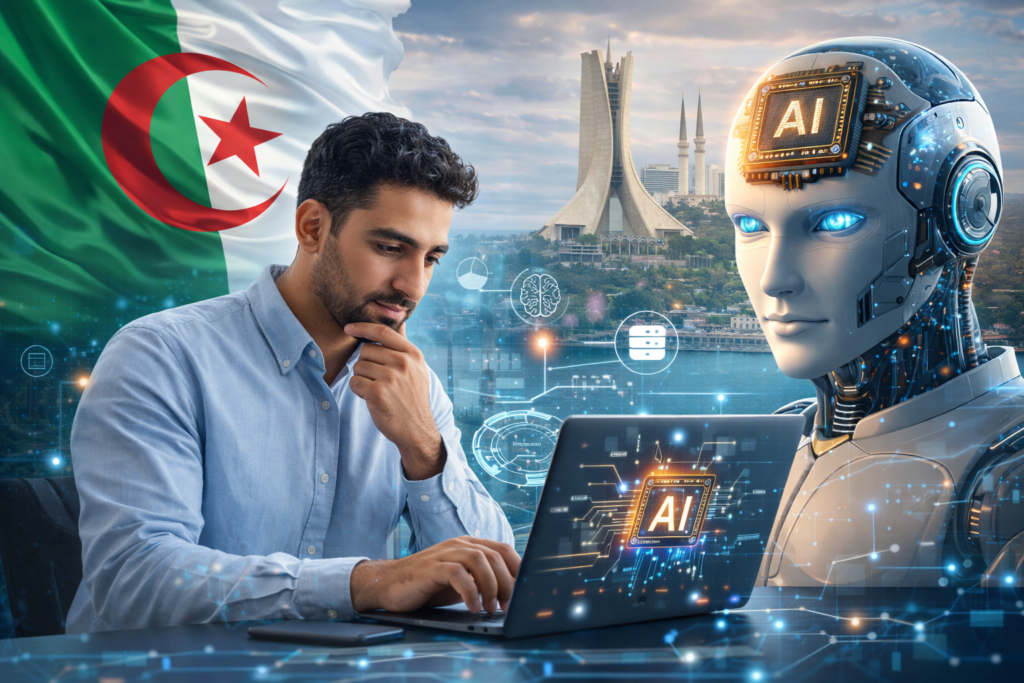La France traverse une crise économique et institutionnelle d’une ampleur inédite à l’approche du vote de confiance du 8 septembre. Le pays aborde un moment de vérité politique qui pourrait redéfinir l’équilibre du pouvoir à Paris.
François Bayrou engagera devant le Parlement la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration de politique générale axée sur la maîtrise des finances publiques et un plan d’économies de près de 44 milliards d’euros.
Rapport de force défavorable au gouvernement
Toutes les principales formations d’opposition (Rassemblement national, UDR, La France insoumise, socialistes, écologistes, communistes) ont annoncé qu’elles voteraient contre la confiance, totalisant près de 330 voix opposées sur 574 députés actuellement en exercice.
Les partis de la majorité présidentielle et alliés ne comptent qu’environ 210 sièges. Face à l’impasse budgétaire et à la montée du mécontentement social, Emmanuel Macron a choisi de soutenir sans réserve son Premier ministre François Bayrou, qui a lui-même pris le risque d’engager la responsabilité de son équipe devant l’Assemblée nationale. Le chef de l’État insiste sur le caractère « responsable » et non « catastrophiste » de la démarche, appelant les partis de gouvernement à éviter toute escalade pouvant plonger la France dans la paralysie.
Aux rangs de la majorité, l’incompréhension domine face à ce « pari impossible », selon plusieurs élus macronistes, conscients de la probabilité d’un rejet de la confiance. Le plan d’ajustement budgétaire porté par Bayrou, qui comprend des mesures impopulaires et un effort d’économies sans précédent, n’a pas permis de rallier de nouveaux soutiens.
Trois scénarios après le 8 septembre
L’issue du vote de confiance façonnera la suite de la crise : Si Bayrou obtient la confiance, contre toute attente, il poursuivrait son projet de réduction de la dette et engagerait les débats parlementaires sur le budget 2026, cherchant à négocier, point par point, les mesures d’économies avec une majorité très fragile.
En cas de rejet, qui reste le scénario privilégié à ce stade, plusieurs options s’offrent à Emmanuel Macron : la nomination d’un nouveau Premier ministre issu de la droite, du centre, voire de la société civile pour un « gouvernement technique » ; ou bien, second scénario, la dissolution de l’Assemblée nationale suivie d’élections anticipées à haut risque pour les équilibres politiques existants.
Enfin, une frange de l’opposition – LFI- met sur la table le débat de la démission présidentielle, alimentant la perspective d’une recomposition politique majeure à la veille de la présidentielle 2027.
Un risque de paralysie institutionnelle
Dans ce contexte, l’exécutif redoute le blocage : mobilisations sociales prévues dès le 10 septembre, blocage du débat budgétaire, et incertitude sur la viabilité d’une majorité parlementaire pour gouverner. La séquence qui s’ouvre interroge non seulement la capacité du président à terminer son mandat, mais aussi la résilience des institutions face à une défiance politique rarement observée depuis 1958, date de la naissance de la 5e republique.