Depuis l’attaque du 7 octobre 2023 et la riposte génocidaire d’Israël, la question palestinienne a retrouvé une centralité qu’elle n’avait plus connue depuis les années 2000. Le conflit de Ghaza a ravivé des fractures anciennes : entre Nord et Sud, entre institutions internationales paralysées et opinions publiques en ébullition, entre États arabes signataires des accords de normalisation et sociétés civiles plus solidaires que jamais du peuple palestinien.
Cette séquence a aussi transformé la manière dont le monde perçoit et raconte le conflit. L’image a précédé la diplomatie, exposant la disproportion des forces et la crise morale d’un ordre international incapable d’empêcher l’impunité. Depuis lors, la question palestinienne s’impose comme un enjeu mondial, à la croisée du droit international, de la mémoire coloniale et des rapports Nord-Sud. Ghaza demeure l’épicentre des tensions politiques et des mobilisations citoyennes.
Les contributions réunies ici prolongent cette réflexion. Six observateurs -journalistes, universitaires, représentants politiques -livrent chacun leur lecture de la portée et des conséquences de l’opération du 7 octobre 2023 et des bouleversements qu’elle a déclenchés : la réaction des sociétés et des élites à travers le monde, ainsi que les dynamiques politiques, sociales et diplomatiques qui dessinent aujourd’hui un nouvel équilibre dans la région.
Ensemble, elles offrent un regard pluriel sur l’évolution de la cause palestinienne, les formes contemporaines de la résistance et les mutations des opinions publiques, tant dans le monde arabe qu’en Occident.

Otman Lahiani
JournalisteDe Gaza à la Cisjordanie : l’impasse d’une solution fragmentée
L’opération du 7 octobre n’est pas déconnectée de l’ensemble du contexte d’occupation et du blocus imposé à la bande de Ghaza depuis plus de dix-sept ans. Par conséquent, elle constitue une réaction prévisible à l’ensemble des pratiques de l’occupation israélienne, qui refuse de lever le blocus imposé au peuple palestinien et continue d’empêcher l’entrée de denrées alimentaires, de médicaments et de fournitures essentielles avant le 7 octobre 2023.
Je crois que le 7 octobre a révélé, à nouveau, le dilemme sécuritaire chronique de l’entité israélienne. Les données indiquent que le taux d’émigration inverse depuis Israël a augmenté de 18 % par rapport à 2022. Parmi les conséquences également, l’opération a entravé le processus de normalisation, qui avançait à grande vitesse durant cette période. Riyad était sur le point de signer des accords de normalisation et Israël était en passe d’obtenir une nouvelle position dans la région.
L’avenir est déterminé par certains facteurs liés à la marge de manœuvre disponible pour les Palestiniens, et pour la résistance en particulier. Il s’avère que le problème de la division palestinienne, ainsi que l’absence d’une décision unifiée, reste l’un des éléments que l’entité israélienne exploite le plus.
Indépendamment de certaines propositions concernant Ghaza, il existe des mutations politiques importantes provoquées par le 7 octobre : l’effondrement et l’érosion du récit sioniste, auprès des sociétés occidentales en particulier, constituent un gain majeur pour la cause palestinienne. Il y a également une transformation au sein des élites de ces sociétés envers la Palestine, et une révision de la position vis-à-vis d’Israël, qui se retrouve dans un grand isolement. L’émergence de la solution de l’État palestinien, dans les négociations internationales, représente également un acquis important.
L’avenir de Gaza demeure complexe, mais il est désormais lié à la solution globale de la question palestinienne. On ne peut parler d’un accord concernant Ghaza sans évoquer des arrangements pour les autres zones palestiniennes, comme la Cisjordanie. C’est le seul cadre dans lequel la résistance peut accepter certaines conditions américaines. Il n’est pas clair si Trump pourra mettre en œuvre sa feuille de route, car ce qui fera exploser cette dernière et entravera sa mise en œuvre ne sera pas les Palestiniens, mais la droite israélienne extrémiste – celle-là même qui a détruit Oslo.

Youcef Hamdane
représentant du Hamas en Algérie« Nous ne permettrons pas qu’on nous arrache par la politique ce que les armes n’ont pu prendre »
Nous traversons une phase difficile, au cours de laquelle l’ennemi, soutenu par l’administration américaine, tente d’arracher des positions et d’imposer une réalité politique visant à effacer la cause palestinienne dans ses différentes dimensions, tout en consacrant la séparation entre les parties de la patrie et en dépouillant la résistance de ses leviers de force, selon l’étendue de l’engagement de l’occupation envers les accords.
Par conséquent, le mouvement comprend les dimensions, les dangers et les objectifs de chaque clause de la proposition américaine, et demande des éclaircissements aux médiateurs concernant les clauses ambiguës et générales qui pourraient ouvrir des portes à des interprétations susceptibles de saper l’essence de l’accord et ses orientations fondamentales.
Nous affirmons que nous resterons fidèles aux sacrifices et aux souffrances de notre peuple. Nous n’avons pas détourné les yeux de nos blessures, qui saignent chaque jour en raison de la poursuite de l’agression, mais nous ne permettrons pas non plus qu’on nous arrache, par des manœuvres politiques, ce que les chars et les avions n’ont pas pu prendre – eux qui ont ciblé nos enfants, nos femmes, notre peuple et nos dirigeants nationaux.
Nous assumons notre responsabilité historique et mûrissons notre réponse avec toutes les parties concernées. Nous aspirons à des positions claires de tous ceux qui soutiennent le droit palestinien et rejettent l’isolement de la cause et du peuple. Ces positions, politiques et populaires, sont importantes par leur temporalité et leur diversité, car elles permettent de consolider l’unanimité autour du droit de notre peuple à résister à l’occupation par tous les moyens et outils, et à rejeter tous les projets de liquidation de la cause ou de tutelle sur le peuple palestinien. Il s’agit également d’élargir l’isolement de l’occupation, de ses projets, de ses instruments et de ses alliés, dans tous les espaces de confrontation avec elle.

Mohamed Hennad
écrivain et enseignant universitaire en science politiqueDu 7 octobre à la libération des consciences
La première conséquence de l’opération du 7 octobre à Ghaza est la confirmation que la cause palestinienne reste vivante, qu’elle ne sera jamais abandonnée, quelles que soient les circonstances, et qu’elle ne peut être enterrée par les accords d’Abraham ou par quelque complot de ce genre. De plus, parmi les résultats du 7 octobre figure la révélation du niveau de criminalité qu’Israël peut atteindre, et du degré d’impuissance de la « communauté internationale », c’est-à-dire des grandes puissances, face à des crimes odieux, sans précédent, commis par un membre des Nations unies.
En outre, il y a une conséquence que personne n’aurait peut-être anticipée : cette libération, qui commence à se produire au sein de l’opinion publique occidentale, laquelle découvre que ses systèmes de gouvernement sont soumis à Israël à un degré qu’elle n’imaginait pas. Portons notre attention sur ces débats qui se déroulent en Occident – y compris dans les parlements, les médias, les réseaux sociaux, ainsi que dans les universités.
Parmi les conséquences également figure la mise en évidence de la stérilité des régimes arabes et islamiques, qui ont démontré qu’ils ne savent rien faire d’autre que réprimer leurs peuples. Cependant, tout ce qui se passe aujourd’hui – notamment les massacres à Ghaza et en Cisjordanie- n’a pas conduit à l’union des dirigeants palestiniens, mais a plutôt accru leur division.
Quant à l’avenir de la cause palestinienne, franchement, je ne vois pas comment les choses évolueront sur le terrain, après tout ce qui s’est passé depuis deux ans. Ce qui est certain, c’est que le monde est désormais plus convaincu que jamais que fermer les yeux sur la résolution de la cause palestinienne n’est pas une solution, et que la paix, dans la région comme au-delà, reste tributaire de cette résolution. De même, la perte d’espoir de mettre fin à l’injustice rend l’opprimé capable de tout, après qu’il n’a plus rien à perdre et qu’il a tout perdu, y compris l’espoir lui-même.
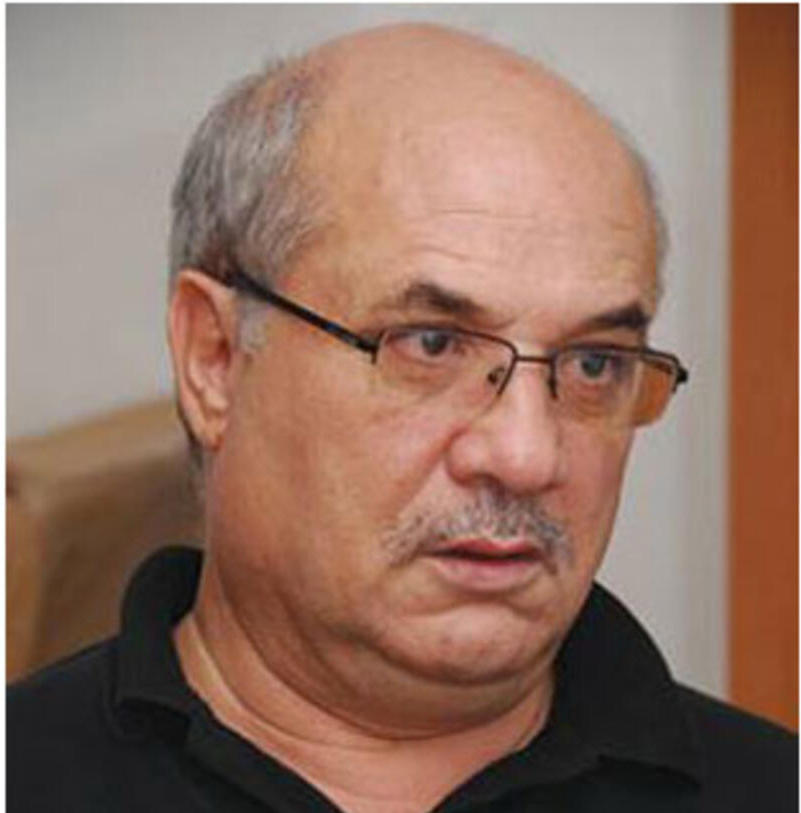
Nacer Djabi
écrivain et enseignant universitaire en sociologie politiqueUne nouvelle élite peut-elle émerger des décombres ?
L’opération du 7 octobre à Ghaza a entraîné, deux ans plus tard, une dégradation extrême de la situation du peuple palestinien. Les destructions massives et la guerre d’extermination ont rendu le territoire invivable, visant probablement à provoquer l’exil des habitants et la fin du pouvoir du Hamas comme de l’Autorité palestinienne.
La cause nationale palestinienne a ainsi perdu plusieurs leviers d’action, ce qui constitue une tragédie sur le plan social : une génération entière voit ses liens avec l’éducation, la santé et la stabilité familiale brisés, ouvrant la voie à de nouveaux phénomènes de violence défensive. Politiquement, l’exclusion du Hamas de Gaza traduit une perte d’autonomie pour les Palestiniens, accentuée par l’isolement international et le consensus américano-israélien contre leur gouvernance.
Cependant, une dynamique d’espoir existe à travers le soutien populaire mondial croissant ,en particulier chez les jeunes générations occidentales, qui pourraient devenir des relais essentiels pour la cause palestinienne. Ce changement de perception appelle l’émergence de nouvelles élites palestiniennes, capables de tirer parti d’un appui à long terme, à l’image du soutien international lors de la guerre du Vietnam.
Enfin, l’avenir de la cause dépend de la capacité de renouvellement et d’adaptation des Palestiniens, ainsi que de la solidarité du monde arabe, alors que la région reste marquée par l’échec des démarches de changement et une faiblesse généralisée.

Ihsane El Kadi
JournalisteDe la fonction de la lutte armée au 21e siècle
J’étais en prison le 7 octobre 2023, et, malgré les témoignages que m’ont rapportés mes avocats, je n’ai pas pu prendre la vraie mesure de l’ampleur et de l’impact de l’offensive du Hamas et des autres factions armées de Ghaza. J’ai ensuite réalisé toute l’importance de la séquence, à la fois en voyant la tournure de l’attaque israélienne, puis en lisant un brillant commentaire du journaliste et écrivain américain Adam Shatz, qui a comparé, par certains aspects, le 7 octobre au soulèvement du 20 août 1955, dans le Nord-Constantinois.
La vraie question que pose, pour moi, le 7 octobre est de savoir dans quelle mesure il est possible de réhabiliter, aujourd’hui, le recours à la violence armée au sein des luttes d’émancipation nationale.
Avant cette date, la tendance dans le monde, depuis la chute du mur de Berlin, puis en particulier après les attentats du 11 septembre 2001, était que la lutte armée entrait en disgrâce -même en soutien aux causes les plus justes, face aux occupants les plus brutaux. Les Palestiniens eux-mêmes, avec les Intifadas de 1987 et de 2000, ont renoncé, pour leur très grande majorité, à la violence armée. Il y a, bien sûr, dans toute offensive insurrectionnelle – comme celle du Têt, au Vietnam, en 1968, ou celle du FLN de Zighoud Youcef -d’inévitables débordements de la violence anticoloniale.
Les ripostes sont toujours disproportionnées et alimentent, finalement, le but politique recherché : la radicalisation populaire et la conviction que, dans la lutte, seules les armes bousculent le statu quo antérieur. Avant le 7 octobre, les Palestiniens mourraient dans un quasi-anonymat, en 2022-2023, au rythme d’un à deux par jour, principalement en Cisjordanie. De ce point de vue, oui, le 7 octobre a rompu le statu quo. Mais dans quel sens ?
En ce qui concerne l’avenir de la Palestine, il faudra plusieurs années avant de pouvoir épiloguer sur les conséquences du 7 octobre 2023. À l’échelle temporelle du 20 août, c’est, toute proportion bien observée, comme si nous étions encore au troisième ou au quatrième jour des représailles, qui ont duré plus d’un mois dans le Nord-Constantinois. Le résultat politique a été engrangé, en une année, par le FLN, au congrès de la Soummam, en août 1956, où toutes les factions du mouvement national -hormis les messalistes -avaient rallié les insurgés du 1er novembre. Dans le cas du 7 octobre, le génocide en cours change la lecture.
Il n’était sans doute pas dans les plans de ceux qui ont décidé de l’attaque de 2023. Il faudra donc de très nombreuses années pour évaluer comment s’intégrera le martyre populaire de ces deux années dans le récit national palestinien. Il sera mesuré à l’aune de ce qu’il permettra d’obtenir, ou non.
À ce stade, il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agit d’un sacrifice populaire vain. Il a stoppé le processus de normalisation des États arabes avec Israël, exhumé la solution à deux États et lui a donné un nouvel élan. Il a aussi disloqué le soutien à Israël dans les opinions occidentales. L’essentiel est là.
Le sort du Hamas, armé ou désarmé, va devenir secondaire. Le chemin sera long, une fois le génocide stoppé, avant un accord de paix et la naissance d’un État palestinien tel qu’esquissé dans les accords d’Oslo.
Ce chemin était totalement obstrué par Israël, son gouvernement expansionniste et ses colons missionnaires. Deux ans après le 7 octobre, il s’entrouvre à nouveau, toujours sous les bombes et l’acharnement criminel. Il s’ouvre quand même. On se souviendra un jour que c’est le recours à la violence armée qui, en révélant la vocation génocidaire de l’occupation, aura rendu la marche en avant à nouveau possible.

Ramdane-Youssef Tazibt
porte-parole du parti des travailleurs (PT)Quand la mobilisation populaire mondiale défie l’impasse diplomatique
Aujourd’hui, la politique fasciste menée par l’entité sioniste et le génocide en cours depuis deux ans à Ghaza ont provoqué une onde de choc mondiale. La nature de cette entité est désormais révélée au grand public dans le monde entier. Des millions de personnes ont manifesté partout sur la planète, dont des milliers de Juifs, aux États-Unis et en Europe, contre la démarche génocidaire de Netanyahu, en lui disant : « pas en notre nom ».
La question palestinienne est à la croisée des chemins, car, contrairement aux opinions publiques dans des dizaines de pays, l’impérialisme américain et les gouvernements européens s’inscrivent dans la feuille de route de Donald Trump, à laquelle adhère même la direction de l’Autorité palestinienne.
À ce stade, la flottille Sumud montre que c’est la mobilisation populaire mondiale qui finira par aider le peuple palestinien à décider de son sort, à exercer son droit universel à la liberté et à fonder son État.
Enfin, aucun gouvernement ni aucune organisation internationale n’est légitime à interdire à un peuple de combattre pour la restitution de tous ses droits, dont le droit au retour des sept millions de réfugiés dans leur terre natale.
Ce dossier a été réalisé dans le cadre des activités du réseau Médias indépendants sur le monde arabe. Cette coopération régionale rassemble Assafir Al-Arabi, BabelMed, Mada Masr, Maghreb Émergent, Mashallah News, Nawaat, 7iber et Orient XXI.

















