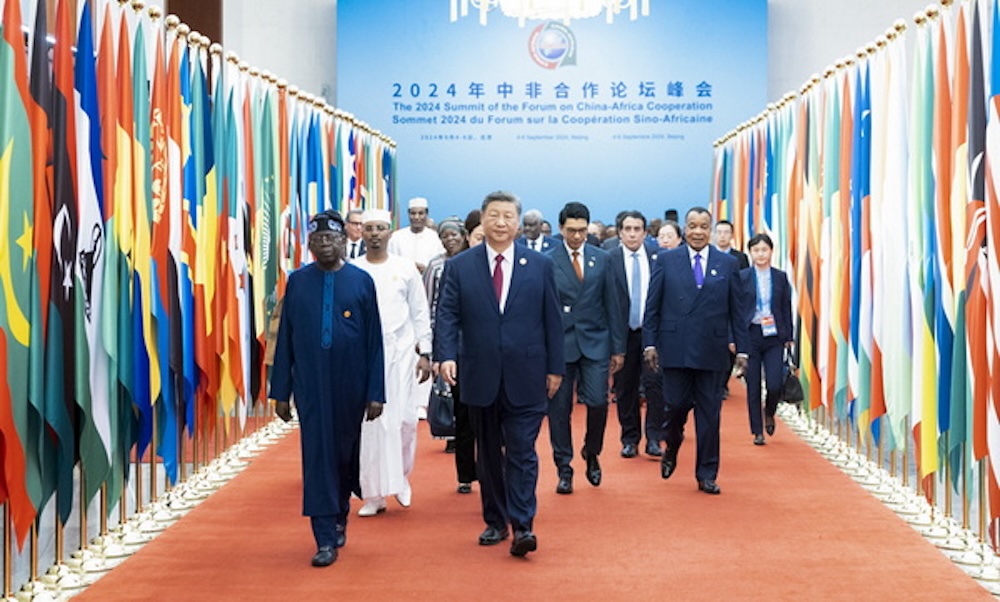Avec 179 milliards de dollars investis depuis 2012, les monarchies du Golfe s’imposent comme de nouveaux maîtres du jeu économique en Afrique.
Longtemps dominée par la Chine et, dans une moindre mesure, par les États-Unis, la scène de l’investissement étranger en Afrique connaît un basculement. Les monarchies du Golfe prennent désormais l’ascendant, déployant des capitaux à une échelle qui redessine les équilibres économiques du continent.
Les chiffres en témoignent. Les États du Conseil de Coopération du Golfe ont engagé près de 179 milliards de dollars d’investissements directs en Afrique entre 2012 et 2025. À elle seule, la période 2022-2023 concentre 113 milliards, soit plus que la décennie précédente cumulée. Cette accélération illustre une stratégie claire : diversifier les débouchés des pétrodollars, au-delà des marchés occidentaux devenus saturés ou incertains.
Les Émirats arabes unis sont à l’avant-garde. Près de 97 milliards de dollars ont été injectés dans les infrastructures portuaires, les énergies renouvelables et l’agro-industrie. Entre 2019 et 2023, leurs investissements atteignent 110 milliards, dont 72 milliards consacrés à la transition énergétique. L’Arabie saoudite suit avec un programme de 41 milliards de dollars prévu sur dix ans, orienté vers les start-ups, les infrastructures et l’énergie. Le Qatar, plus discret, prépare un plan d’engagements évalué à 103 milliards de dollars.
Certaines opérations traduisent l’ampleur du phénomène. En 2023, un fonds émirati prend le contrôle de 51 % de Mopani Copper Mines en Zambie pour 1,1 milliard de dollars. L’appétit du Golfe pour les ressources africaines dépasse ainsi le pétrole et s’étend au cuivre, à la logistique et aux télécoms. Dans le solaire et l’éolien, les Émirats multiplient les projets en Afrique de l’Est et australe. Le Qatar renforce sa présence dans la finance et les télécommunications, secteurs clés pour l’intégration économique continentale.
À Alger, l’IATF 2025 consacre l’influence du Golfe
L’Intra-African Trade Fair (IATF 2025) organisée à Alger a donné une caisse de résonance à ce mouvement. Les débats ont souligné à la fois l’opportunité et les risques.
Pour l’économiste Osama Fahmy, l’Afrique doit « dépasser le rôle de simple fournisseur de matières premières » et exiger des partenariats industriels créateurs de valeur. De son côté, Raed Ashhab, directeur de Savola Foods Algérie, a rappelé le poids du déficit logistique : « Sans routes, rails et règles harmonisées, les flux commerciaux resteront limités, même avec des milliards sur la table. »
En 2024, le continent a attiré 97 milliards de dollars d’IDE, un record représentant 6 % des flux mondiaux. Une part croissante de ces capitaux vient désormais du Golfe. L’attrait est renforcé par la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui ouvre un marché de 1,4 milliard de consommateurs.
Derrière ces chiffres spectaculaires, une équation reste entière : l’Afrique est-elle en train de conquérir une nouvelle autonomie financière ou simplement de substituer une dépendance à une autre ? Les capitaux du Golfe, abondants et rapides à se déployer, offrent des perspectives inédites pour l’industrialisation et l’intégration du continent. Mais leur efficacité dépendra moins des milliards annoncés que de la capacité des États africains à imposer leurs priorités, à bâtir des cadres réglementaires solides et à transformer ces flux en valeur ajoutée locale.