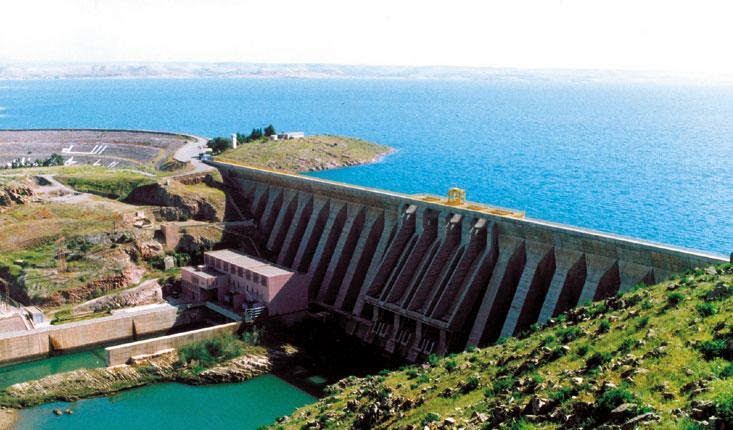Un nouveau rapport consacré aux interdictions de sortie du territoire national (ISTN) met en lumière un recours croissant et systématique à ce dispositif en Algérie. Rédigé par une organisation spécialisée en droits humains basée à Genève , la MRG, le document décrit une transformation profonde de l’ISTN : d’une mesure judiciaire exceptionnelle, elle serait devenue « un instrument courant de contrôle politique et administratif ». Selon les auteurs de la Mena Rights Group , l’ISTN est appliquée de manière opaque, souvent sans notification officielle, privant les personnes ciblées de tout droit de recours effectif et installant un climat d’incertitude et de crainte. Le rapport affirme que l’instrument, d’abord présenté comme un outil de lutte contre la corruption et la menace terroriste, s’est progressivement étendu à un large spectre de citoyens, au-delà des activistes et opposants politiques directement visés depuis le mouvement Hirak.
Une pratique arbitraire nourrie par le flou juridique
Le rapport relève que l’ISTN repose sur une architecture juridique insuffisamment encadrée, qui ouvre la voie à des dérives. Dans de nombreux cas, les personnes visées ne sont pas informées officiellement de la décision : elles découvrent l’interdiction lors d’un contrôle frontalier. Cette absence de notification complique toute contestation devant la justice et crée une zone grise dans laquelle l’administration conserve une latitude totale. Les auteurs rappellent que, sur le plan international, le droit de quitter son pays est garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Or l’application actuelle de l’ISTN ne respecterait pas ces exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Le rapport rappelle que l’article 87 bis du code pénal, consacré à la lutte contre le terrorisme, est critiqué par plusieurs experts de l’ONU pour sa formulation vague permettant d’interpréter des actes pacifiques comme des atteintes à la sûreté de l’État. Ce flou sert de base à l’imposition d’ISTN prolongées ou renouvelables sans limitation claire, dans un contexte où les procédures pénales peuvent s’étendre sur de longues périodes sans jugement. Pour les auteurs, cette dérive traduit une volonté politique de « neutraliser » des profils jugés sensibles, par une mesure administrativo-judiciaire moins visible qu’une incarcération mais tout aussi restrictive.
De l’opposition politique aux élites administratives et économiques
Si l’outil a été massivement utilisé contre les militants, journalistes et défenseurs des droits humains depuis 2019, l’étude montre une extension vers d’autres catégories socioprofessionnelles. Dès les premières vagues judiciaires post-Hirak, plusieurs hommes d’affaires liés à l’ancien cercle présidentiel ont été placés sous ISTN, souvent suivies de condamnations. Cette séquence a servi de fondement à une généralisation progressive de la mesure contre les acteurs économiques : dirigeants du secteur privé, cadres du secteur public et responsables d’entreprises nationales. Entre 2019 et 2020, plusieurs dizaines de chefs d’entreprise ont ainsi été concernés, parfois sans information formelle. La réouverture post-Covid a rendu visibles de nombreux cas : certains cadres ne pouvaient plus justifier leur absence à l’étranger ou participation à des salons internationaux. Le rapport souligne également l’usage croissant de l’ISTN à l’encontre d’anciens hauts fonctionnaires, de responsables administratifs en fin de mission, de magistrats, de cadres sécuritaires ou de responsables ministériels, parfois dans le cadre d’enquêtes préliminaires non encore conclues. Selon les témoignages cités, beaucoup choisissent le silence pour ne pas « aggraver » leur situation, attendant que leur dossier soit « réglé discrètement ». Ce mécanisme produit un effet d’autocensure et alimente l’idée que l’ISTN est désormais un outil de contrôle interne des élites politico-administratives et économiques, au-delà de sa fonction judiciaire initiale.
Une stratégie de gestion du risque politique
Dans sa lecture globale, le rapport estime que l’ISTN s’est installée comme un instrument structurel de gestion du risque politique et social. La mesure, d’apparence technocratique, permet de limiter les déplacements internationaux, de restreindre l’accès à des réseaux diplomatiques, médiatiques et financiers, et d’isoler symboliquement les personnes visées. Ce mode opératoire, selon les auteurs, se déploie dans un contexte plus large de rétrécissement de l’espace civique : surveillance renforcée des associations, judiciarisation des expressions critiques, renforcement du contrôle administratif et réactivation de dispositifs liés à la sûreté nationale. En pratique, la capacité de l’État à maintenir un flou sur la base légale des mesures et leur durée augmente son pouvoir dissuasif : le rapport évoque des individus empêchés de voyager sans notification, ou encore informés que leur interdiction était « toujours en cours » sans échéance ni justification.
Recommandations pour un retour à un usage encadré
Le document se conclut par une série de recommandations destinées aux autorités algériennes : encadrement strict des motifs d’ISTN, notification obligatoire, durée limitée et possibilité de contrôle judiciaire effectif. Il appelle à revoir la définition pénale du terrorisme pour éviter les interprétations extensives, et à mettre en place un système transparent d’enregistrement et de recours administratif. Les auteurs insistent également sur la nécessité de cesser l’usage de l’ISTN contre les individus ne présentant aucun risque concret, et de garantir que l’instrument ne serve plus de mécanisme de sanction extrajudiciaire. L’objectif affiché est clair : replacer l’ISTN dans un cadre conforme aux normes constitutionnelles et internationales, et rompre avec son utilisation comme « outil de répression massive ». Selon le rapport, seule une réforme structurelle et une volonté politique explicite permettront de restaurer la confiance et d’assurer une cohérence entre l’État de droit proclamé et les pratiques administratives.