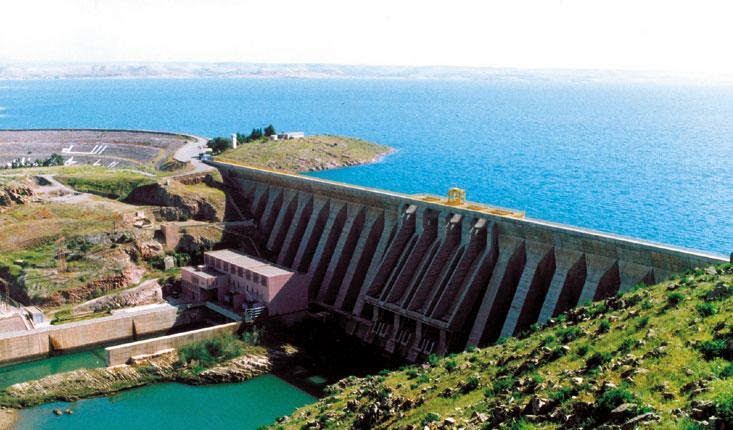D’habitude, quand une université algérienne reçoit de l’argent, elle le dépense. Cette année, elle l’investit. La nuance tient dans le choix d’une structure juridique particulière : une holding.
Le 1er novembre 2025, l’Université d’Alger 3 a lancé le premier fonds d’investissement universitaire du pays avec 120 millions de dinars. L’annonce officielle met en avant le montant, l’objectif de 330 millions d’ici la fin d’année et les start-ups qui seront financées. Mais la vraie rupture est ailleurs. Elle est dans la forme juridique : une société holding.
Traditionnellement, une université algérienne fonctionne avec des enveloppes budgétaires annuelles. L’argent arrive, se dépense selon des lignes précises, et disparaît. L’année suivante, on recommence. Avec une holding, la logique change du tout au tout. Ce véhicule juridique peut accumuler du capital, créer des filiales, prendre des participations dans des start-ups, négocier des royalties sur des brevets. Il ne se contente pas de dépenser : il investit avec l’espoir de générer des revenus.
Concrètement, cela signifie que l’université peut désormais avoir un bilan qui s’étoffe année après année, comme une entreprise. Elle peut arbitrer entre plusieurs projets, prendre des risques calculés sur certains, diversifier son portefeuille. Elle devient, en théorie du moins, un acteur économique à part entière.
L’Université d’Alger 3 compte déjà 134 incubateurs, 256 start-ups actives sur les marchés national et international, et 3 249 brevets déposés. Les chiffres donnent une idée du potentiel : 76 prototypes sont finalisés, et 54 projets nationaux sont en cours de valorisation.
L’autonomie de décision, jusqu’à quel point ?
La vraie question derrière ce choix de structure, c’est celle du pouvoir. Qui décide dans cette holding ? Son conseil d’administration dispose-t-il d’une marge de manœuvre réelle ou reste-t-il sous la tutelle étroite du ministère de l’Enseignement supérieur ?
Le test de ce nouveau modèle sera dans l’exécution : combien de temps entre l’identification d’un projet innovant et le premier virement ? Quels garde-fous existent pour éviter la paralysie administrative ?
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé que les étudiants créateurs de brevets pourront percevoir entre 60% et 80% des recettes générées par la cession de leurs inventions à une entreprise, dans le cadre d’un nouveau texte réglementaire en préparation.
Des revenus récurrents plutôt que des dépenses ponctuelles
L’autre avantage d’une holding, c’est sa capacité à construire des flux de revenus durables. Avec les 3 249 brevets déposés par l’Université d’Alger 3, le potentiel existe pour structurer des accords de licence avec des entreprises, prendre des participations dans les start-ups qui exploitent ces brevets, ou négocier des royalties sur les produits commercialisés.
Si le ministre tient sa promesse de reverser 60 à 80% des revenus aux étudiants créateurs, la holding conserve 20 à 40% pour se refinancer. L’argent investi dans un projet peut rapporter assez pour financer d’autres projets, sans attendre une nouvelle ligne budgétaire.
Le fonds démarre à 120 millions de dinars et vise 330 millions d’ici la fin 2025. D’où viendront ces 210 millions supplémentaires ? La réponse dira tout de la viabilité du modèle.
Si c’est l’État qui abonde via le ministère ou d’autres enveloppes publiques, on reste dans un schéma classique de financement descendant. Mais si une partie provient des revenus générés par les premières opérations de la holding, des cessions de brevets ou des dividendes de start-ups, l’université commence à s’autofinancer partiellement.
Un précédent pour d’autres universités
Le ministère a annoncé plusieurs initiatives complémentaires : la mise en place d’un guichet unique dans chaque université pour accompagner les étudiants dans la formalisation de leurs activités économiques, ainsi qu’un projet d’introduction en Bourse de filiales issues de trois centres de recherche. L’université abrite également un centre d’appui aux technologies et à l’innovation, en partenariat avec l’INAPI, pour protéger les brevets et les droits de propriété industrielle des étudiants.
Par ailleurs, à partir de 2027, les diplômés seront activement orientés vers des parcours “diplôme-start-up” ou “diplôme-entreprise économique”, ce qui confirme l’ambition de transformer structurellement le rôle de l’université dans l’écosystème entrepreneurial.