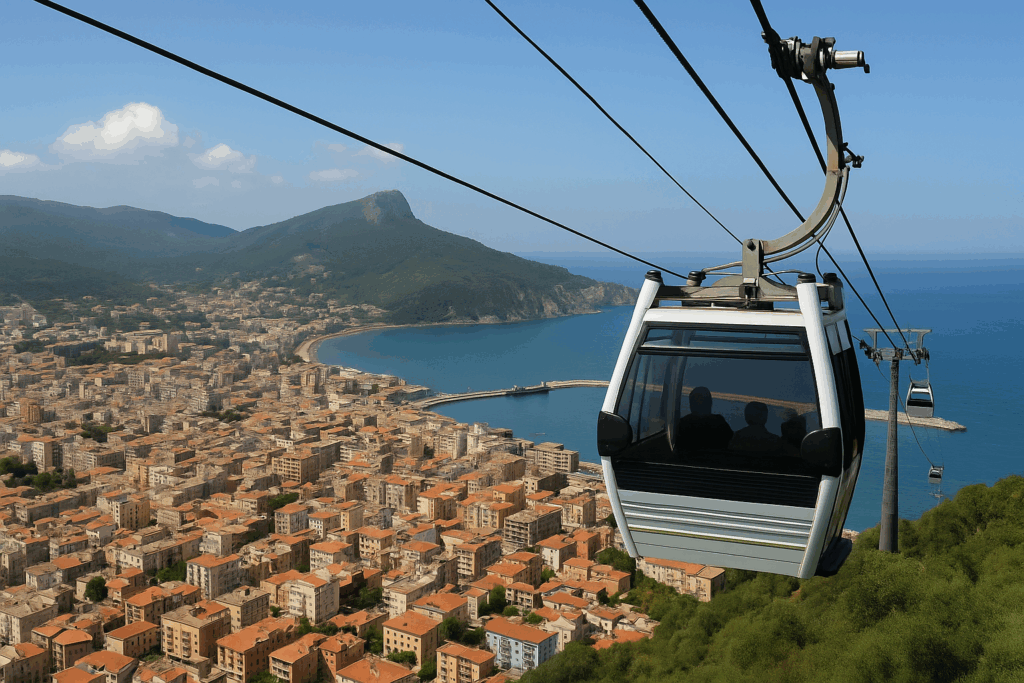Les relations entre l’Algérie et la France restent marquées par des épisodes de tension liés au lourd héritage du passé colonial. Cette semaine, en marge de la 69ᵉ Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne, Alger a ravivé le dossier sensible des essais nucléaires menés par la France dans le Sahara durant les années 1960.
Pour la première fois, la délégation algérienne a projeté un documentaire inédit montrant l’état actuel des sites touchés par ces explosions. Images, témoignages et analyses scientifiques ont dressé un tableau alarmant : sols contaminés, radiations persistantes et séquelles sanitaires sur des générations entières. La salle a retenu son souffle devant ce récit visuel, qui donne une dimension encore plus tangible aux accusations algériennes.
Les experts présents ont rappelé que l’Algérie avait pris des mesures pour atténuer ces effets, mais que l’ampleur des dégâts nécessitait une responsabilité claire de la part de la France.
Un événement marquant sur la scène internationale
L’initiative algérienne à Vienne n’était pas un simple rappel diplomatique : elle marque une étape inédite dans la bataille mémorielle. Jusqu’ici, Alger avait surtout porté ses revendications sur le terrain politique ou bilatéral. En choisissant l’AIEA, une instance multilatérale, le message prend une nouvelle dimension.
La présence de diplomates, de délégations internationales et de cadres de l’AIEA a donné à cette rencontre une résonance mondiale. En projetant des preuves visuelles et en organisant une discussion scientifique, l’Algérie a voulu sortir ce dossier du cadre purement historique pour le placer dans l’agenda environnemental et sanitaire international.
Les responsables algériens ont rappelé que dans ces régions du Sud, autrefois théâtre d’explosions, les conséquences invisibles des radiations sont toujours là. Cancers, malformations congénitales et contamination des sols restent des réalités, confirmées par des associations locales qui recueillent témoignages et données médicales.
Selon les estimations de l’APS en 2012, au moins 30 000 Algériens auraient souffert de maladies liées à ces expérimentations. Des associations comme Taourirt ou celle du « 13 février 1960 » militent depuis des années pour une reconnaissance internationale, allant jusqu’à évoquer un « crime contre l’humanité ».
Pourtant, la réponse française demeure timide. La loi Morin de 2010 a mis en place un comité d’indemnisation, mais sur les 1 739 dossiers déposés, seuls 52 provenaient d’Algérie, et un seul a abouti à une indemnisation. Un constat accablant, souvent justifié par Paris par le manque de preuves ou de documents fiables.
Une mémoire vive qui continue de peser sur la relation
À travers cette initiative à Vienne, l’Algérie a choisi de transformer la mémoire en outil diplomatique. En portant le sujet sur la scène internationale, Alger rappelle que la réconciliation entre les deux pays ne pourra se faire sans un règlement de ce passé colonial.
La projection du documentaire marque une rupture symbolique : désormais, ce ne sont plus seulement des mots ou des chiffres, mais des images et des témoignages qui interpellent la communauté internationale. La France se retrouve une nouvelle fois face à son histoire, sommée d’assumer ses responsabilités morales et juridiques.
Les relations algéro-françaises, déjà fragilisées par d’autres dossiers – visas, coopération sécuritaire, mémoire coloniale – se trouvent donc à nouveau confrontées à ce contentieux brûlant. La conférence de Vienne restera, à ce titre, comme un épisode marquant où l’Algérie a su donner un nouvel écho à la souffrance de ses populations du Sud.